
Sylvain Gouguenheim
Il y a le livre de Sylvain Gouguenheim, il y a l’affaire Gouguenheim. L’affaire est aussi intéressante que le livre. Celui-ci traite, comme l’indique le titre, des racines grecques de l’Europe chrétienne et plus particulièrement, comme le titre ne l’indique pas, du transfert de l’héritage culturel grec à l’Europe médiévale par le canal arabe et andalou. C’est ce dernier point qui fait débat. Il a suscité la colère de dizaines d’universitaires contre leur collègue, cible d’un harcèlement digne des procès rouges.
De quoi s’agit-il ? De ce que Gouguenheim, en effet, a « cassé la baraque », du moins l’a sérieusement écornée. La baraque en question, c’est, dit-il, « l’image biaisée d’une chrétienté à la traîne d’un islam des Lumières, auquel elle devrait son essor, grâce à la transmission d’un savoir grec dont l’époque médiévale avait perdu les clés ». Ce « parti pris idéologique » assez récent occulte quelques vérités majeures. Une clarification a donc paru nécessaire à Sylvain Gouguenheim dont l’ambition, modeste, est de « mettre à la disposition du grand public les travaux des érudits ». Si l’auteur est un authentique médiéviste, professeur à l’ENS de Lyon, il ne se tient pour spécialiste ni de l’islam ni de la transmission de l’héritage grec. Suivons donc ce modeste en son argumentation, que cinq chapitres ordonnent.
1. Dans l’Europe des premiers siècles subsistent, « foyers épars dans un vide immense », quelques noyaux grecs : en Sicile, en Italie du Sud, à Rome. Au Nord cependant, le souvenir de la culture antique reste vivace et le désir de Grèce manifesté par les Carolingiens, de Pépin le Bref à Charlemagne, suscitera une première « renaissance ». Au XIIe siècle, les traductions d’Aristote, faites directement du grec au latin, verront le jour au Mont Saint-Michel – on y reviendra – mais aussi dans la France du Nord et en Angleterre.
2. C’est pourtant l’Orient qui fournira au savoir grec le cadre efficace de sa survie : à Byzance sans doute, mais aussi dans l’Orient asiatique et bientôt musulman, grâce aux travaux « gigantesques et méconnus » des chrétiens syriaques, tant traducteurs que savants. Dès la fin du IVe siècle on s’attache à traduire Aristote, besogne qui sera poursuivie jusqu’au XIe. Ce n’était pas en effet une mince affaire que cette acrobatie linguistique, passant du grec au syriaque et du syriaque à l’arabe en attendant l’aboutissement européen, de l’arabe au latin. Traducteurs, les Syriaques étaient aussi créateurs ; la médecine arabe, justement réputée au temps des Abbassides, fut, pour l’essentiel, leur œuvre et les califes de Bagdad confiaient le soin de leur santé aux mains expertes de la famille des Bakhtîshu, médecins de père en fils.
3. Justice rendue aux chrétiens syriaques, c’est aux « moines pionniers » d’Occident que le justicier Gouguenheim rend ensuite hommage, et au premier d’entre eux, « Jacques de Venise, dit le Grec, philosophe », ainsi que se présente lui-même cet homme dont on sait peu. On sait peu de chose de sa personne, mais beaucoup de son œuvre puisque les manuscrits de ses traductions d’Aristote sont conservés à la bibliothèque municipale d’Avranches. Or, voici l’important, son travail fut effectué dans le deuxième quart du XIIe siècle, directement du grec au latin, les premières traductions espagnoles, faites de l’arabe au latin sous l’impulsion de l’archevêque Jean de Tolède (1152-1166), n’étant pas encore parvenues en Europe du Nord.1 Plusieurs dizaines d’années (peu sans doute, mais essentiel pour la thèse de l’auteur) séparent donc les deux latinisations de l’héritage aristotélicien. Les traductions de Jacques de Venise étaient diffusées au XIIIe siècle en plusieurs centaines de manuscrits ; un véritable engouement pour la philosophie grecque est ainsi attesté, que ne réussirent pas à freiner les réticences de la papauté envers les livres naturalistes d’Aristote et sa Métaphysique.
4. Le savoir grec retrouvé en Occident latin, quel fut son sort au pays dont on dit, non sans raison, qu’il nous revint ? Sans peur, Gouguenheim conteste que la mise à la disposition des locuteurs arabes, par les Syriaques, dudit savoir ait engendré un « Islam des Lumières ». C’est que dans les débuts de la religion nouvelle, la fixation du texte coranique accapare les esprits et que le savoir grec a été soumis au crible musulman. Le concept de ‘ilm, traduit souvent par « science », ne concerne que la science coranique et c’est dans ce seul registre que la logique trouva application, fût-elle maniée par les praticiens du kalam ou les mu’tazilites. On ne s’étonnera donc pas que la théodicée naturelle d’Aristote ait répugné aux ulémas. Elle répugna tout autant à l’Église chrétienne ; mais celle-ci eut son Thomas d’Aquin ; point de Thomas en islam ! En résulta que la réappropriation du savoir grec en Occident fut proprement bouleversante ; alors qu’en Islam on ne prit d’Aristote que sa logique, et que son influence fut nulle sur la politique, la morale… et la métaphysique.
5. Faisant un pas de plus dans ce que ses adversaires jugent provocation, l’auteur aborde, en un dernier chapitre, les « problèmes de civilisation ». Les Européens doivent presque tout aux Grecs, les musulmans presque rien. C’est la curiosité qui fait le partage. L’Islam se suffit à lui-même, l’Occident est toujours en recherche. L’incompatibilité a un fondement religieux : la lettre du Coran est complète, indépassable, rien à en dire ; notre Bible « raconte des histoires », on peut causer.
Revenons, pour finir, à la querelle dont nous disions en commençant qu’elle était aussi intéressante que le livre qui l’a suscitée. Sans doute peut-on reprocher à Sylvain Gouguenheim de trop abaisser les mouvements intellectuels des premiers siècles de l’islam, et notamment celui du mu’tazilisme, dont le retour actuel dans la communauté musulmane est prometteur. Mais son propos est solidement étayé et constitue une saine réaction à un islamiquement correct poussé par l’air du temps. Il semble que ce soit Le Monde qui, sous la signature de Roger-Pol Droit, ait mis le feu aux poudres. Que notre grand quotidien, dont on connaît l’orientation politique discrète, ait loué le livre de Gouguenheim, c’en était trop pour les plus militants de nos universitaires ?
Claude Le Borgne, « Aristote au Mont Saint-Michel, les racines grecques de l’Europe chrétienne » Revue n° 715 Janvier 2009 – p. 183-184
Auteur(s) de l’ouvrage : Sylvain Gouguenheim Seuil, 2008 ; 280 pages

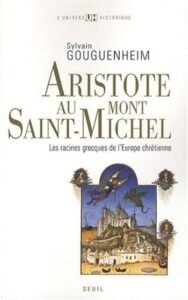 1 À peine paru, l’ouvrage de Sylvain Gouguenheim a déchaîné une virulente polémique. Divers auteurs, généralement islamisants ou spécialistes de philosophie médiévale, ont accusé S. Gougenheim d’avoir, en niant l’apport arabe à la culture médiévale occidentale, donné une pseudo-caution historique aux thèses habituelles de l’islamophobie contemporaine. Sans préjuger des intentions réelles ou supposées de l’auteur et de l’usage politique qui pourrait être fait de tel ou tel passage de son livre, essayons de nous en tenir à celui-ci et à ce que le lecteur non prévenu – s’il en existe encore – pourrait y trouver.
1 À peine paru, l’ouvrage de Sylvain Gouguenheim a déchaîné une virulente polémique. Divers auteurs, généralement islamisants ou spécialistes de philosophie médiévale, ont accusé S. Gougenheim d’avoir, en niant l’apport arabe à la culture médiévale occidentale, donné une pseudo-caution historique aux thèses habituelles de l’islamophobie contemporaine. Sans préjuger des intentions réelles ou supposées de l’auteur et de l’usage politique qui pourrait être fait de tel ou tel passage de son livre, essayons de nous en tenir à celui-ci et à ce que le lecteur non prévenu – s’il en existe encore – pourrait y trouver.
2 Il faut dire que la nature même de l’ouvrage est délicate à définir. Il ne s’agit pas d’une recherche originale et S. Gouguenheim n’est à ma connaissance ni helléniste, ni arabisant. Son travail s’appuie avant tout sur d’abondantes lectures (voir la « bibliographie sélective » aux p. 263-278), comportant à la fois quelques sources imprimées et de nombreux travaux anciens ou récents. Il en résulte que l’A. est dépendant de ses sources d’information, mais qu’il a pu aussi les sélectionner en fonction des thèses qui lui tenaient à cœur ; on aurait parfois aimé que la parole fût donnée aux tenants des positions que l’A. récuse, mais sans les exposer vraiment. Un second aspect un peu déroutant vient de ce que l’A. a juxtaposé des chapitres consacrés à des points précis (chap. i et iii relatifs aux traductions de textes grecs et à leur diffusion en Occident) à d’autres, déjà plus larges, traitant des destinées de l’hellénisme dans l’Orient syriaque et arabo-musulman (chap. ii et iv), pour terminer par une sorte d’essai très général sur les notions d’identité, de civilisation et de contact entre civilisations (chap. v). Il y a là une série de sauts épistémologiques où il est parfois difficile de suivre l’auteur.
3 Le sous-titre même du livre – « Les racines grecques de l’Europe chrétienne » – reflète bien l’ambiguïté de cette démarche. S’il était simplement agi de l’« Europe médiévale », les choses eussent moins suscité la polémique.
4 Car l’idée initiale ne prête guère à contestation et est généralement admise aujourd’hui par les spécialistes. Malgré l’oubli à peu près complet du grec à partir du ve s., l’Occident est toujours resté conscient de tout ce que la culture antique, dont il se voulait l’héritier, devait à la philosophie et à la science grecques. Conscience d’autant plus vive qu’à l’héritage culturel s’ajoutait l’héritage chrétien. Le grec, même rendu inutile par la Vulgate, n’avait-il pas été la langue du Nouveau Testament, celle de l’Église primitive, des Pères et des premiers Conciles, celle enfin, jusqu’au viie s., de la papauté ? Il n’est donc pas étonnant que, malgré les difficultés pratiques, l’Occident ait toujours été friand de textes philosophiques, scientifiques ou religieux traduits du grec. Du ve au xiie s., le fil des textes traduits du grec et plus ou moins diffusés en Occident s’est donc maintenu, ténu certes mais jamais interrompu. Avec un grand luxe de détails, S. Gouguenheim fait l’inventaire de ces traductions. Il rappelle, ce que les spécialistes ont bien établi depuis quelques années, que ces traductions, déjà nombreuses à l’époque carolingienne, se sont multipliées dans la première moitié du xiie s., essentiellement en Italie (Sicile, Pise, Venise). Au premier rang des textes alors traduits, ceux de la logica nova et de la philosophie naturelle d’Aristote ; au premier rang des traducteurs, Jacques de Venise, personnage à dire vrai fort mal connu mais dont S. Gouguenheim, à la suite de C. Viola (à qui il emprunte le titre même de son livre, Aristote au Mont-Saint-Michel), fait un éloge vibrant, tout en imaginant qu’il a pu séjourner de manière prolongée dans le grand monastère normand où l’on retrouve une partie de ses manuscrits (aujourd’hui à Avranches). Dès le milieu du xiie s., la plus grande partie de l’œuvre philosophique d’Aristote, directement traduite sur les originaux grecs, aurait été ainsi accessible en Occident (p. 123).
5 Soit, mais les conséquences qu’en tire, implicitement ou explicitement, l’A., sont plus discutables. Mes réserves peuvent se ramener à quatre.
6 La première est que le nombre et l’ancienneté des traductions réalisées directement à partir du grec n’autorisent pas à tenir pour négligeables celles simultanément ou ultérieurement faites de l’arabe et qui ne concernent d’ailleurs pas seulement des textes philosophiques et scientifiques d’origine grecque, mais aussi un grand nombre de commentaires et traités originaux produits par des auteurs arabophones. Si les traductions de Jacques de Venise et quelques autres avaient suffi aux besoins culturels de l’Occident, pourquoi les grandes entreprises « espagnoles » que symbolisent les noms de Gérard de Crémone et Michel Scot auraient-elles pris une telle ampleur ? Il aurait fallu essayer de comparer la diffusion et le succès respectifs de ces deux courants de traductions, pas seulement au Mont Saint-Michel, mais là où elles importaient vraiment, c’est-à-dire dans les milieux scolaires et universitaires. Faute de cette comparaison systématique, l’affirmation de la primauté absolue des traductions faites directement sur le grec ne peut emporter la conviction. À cet égard, il faut bien constater que S. Gouguenheim a quelque peu biaisé la question en s’arrêtant, pour l’essentiel, à la fin du xiie s., c’est-à-dire à l’époque pré-universitaire.
7 Second point discutable, non seulement l’assimilation de l’héritage grec à la parfaite manifestation du logos et de la raison, mais surtout l’idée d’une totale consonance de cet héritage grec à la culture médiévale occidentale. Or non seulement cet héritage était très partiel, se limitant à Aristote et un certain nombre de textes scientifiques, à l’exclusion à peu près complète de Platon et de toute la littérature, mais sa « réception », comme on sait, s’est heurtée, du xiie au xive s., à de vives résistances, voire à des condamnations répétées. Cette défiance vis-à-vis de l’héritage grec s’étendait même au domaine religieux et les théologiens du xiiie s. mettront plus d’ardeur à rédiger des Contra errores Graecorum qu’à rechercher dans l’orthodoxie les marques encore présentes de l’Église primitive. Significatif à cet égard me paraît le fait que pratiquement aucun des grands intellectuels médiévaux, d’Abélard à Oresme en passant par Albert le Grand et Thomas d’Aquin, n’a cherché à apprendre lui-même le grec. Et plus largement, on ne peut pas dire que la IVe Croisade et la prise de Constantinople en 1204 traduisent une attitude de respect et de sympathie vis-à-vis du legs hellénique.
8 Troisième point de la démonstration de S. Gouguenheim qui suscite quelques réserves, l’insistance qu’il met à souligner que beaucoup des traductions de textes grecs en arabe (souvent via un intermédiaire syriaque) ont été le fait de chrétiens ou de juifs orientaux (arabophones). Le fait est incontestable, même s’il y eut aussi des traducteurs musulmans. Mais peut-on affirmer pour autant que les premiers appartenaient à un univers culturel totalement différent de celui des musulmans arabophones qui étaient, de toute façon, les destinataires principaux de ces traductions. À quoi il faut ajouter, rappelons-le, que les textes arabes ultérieurement traduits en latin n’étaient pas seulement des textes d’origine grecque, mais aussi des œuvres arabes originales, dont les auteurs ont été parfois des chrétiens orientaux, mais plus souvent des musulmans, à commencer par Avicenne et Averroès. Et, de toute façon, les traducteurs et lecteurs occidentaux, qui n’avaient souvent qu’une idée assez vague de la personnalité et de l’identité ethnique et religieuse des auteurs dont ils traduisaient ou lisaient la production, faisaient-ils la différence ? Ils savaient simplement qu’il s’agissait, globalement, de textes « arabes » ; ils n’y décelaient guère sans doute de caractère proprement « musulman » – ce qui eût poussé à les rejeter – mais les concevaient comme des vecteurs parfaitement légitimes, soit de la science et de la sagesse grecques, soit d’une science et d’une sagesse spécifiques, quoique dérivées des précédentes et en facilitant par conséquent l’accès.
9 Que ces textes n’aient représenté de toute façon qu’un volet minoritaire de la culture arabe, à côté des textes religieux, juridiques ou historiographiques, est évident – et on en dirait autant de la culture chrétienne occidentale, dominée elle aussi par les productions religieuse, juridiques et historiographiques – mais cela n’enlève rien à la réalité des transferts qui se sont réalisés par le biais de ces traductions. L’existence de ces transferts ne doit pas déboucher sur une conception aseptisée des rapports entre chrétienté et islam médiévaux ; l’étude de ceux-ci doit prendre en compte toutes leurs facettes (commerciales, ethniques, militaires) et fera évidemment apparaître autant et plus d’épisodes de confrontation violente que de coopération ou d’échanges. Le champ de la culture savante, qui ne concernait au demeurant, de part et d’autre, qu’un nombre limité d’individus, n’est qu’un des volets du problème. D’autre part, on peut admettre que l’échange a été assez unilatéral et que le monde arabe a plus apporté – volontairement ou involontairement – à l’Occident qu’il n’en a reçu. Mais cette inégalité dans l’échange doit-elle être interprétée comme une preuve de l’« incapacité » de l’Islam à s’ouvrir à l’« autre » ?
10 Or c’est bien ce que semble suggérer le dernier chapitre du livre de S. Gouguenheim et de manière d’autant plus contestable que, par une sorte de glissement essentialiste, l’auteur passe alors de l’Islam médiéval à une sorte d’Islam intemporel, en soi. Pour des raisons à la fois linguistiques (le caractère « essentiellement religieux et poétique » des langues sémitiques et de l’arabe en particulier), psychologiques et religieuses, l’Islam aurait été irrémédiablement rétif au rationalisme, à la science, à la découverte, autocentré sur ses convictions religieuses et son système théologico-juridique. Même appuyées sur quelques autorités et étayées par une analyse cavalière du mu‘tazilisme, de telles affirmations, ainsi présentées, relèvent plus de la littérature d’humeur que de la démonstration scientifique et rendent impossible le débat qu’elles prétendaient instaurer.
11 Malgré les réserves exprimées, ce qu’on vient de lire n’est pas une condamnation ni un appel à la censure. Le livre de S. Gouguenheim s’exprime en termes clairs et ne manquent pas de références vérifiables. À chacun donc de le lire et de se faire une idée par soi-même. Il faut faire confiance à l’intelligence du lecteur.
Jacques Verger, « Sylvain Gouguenheim. – Aristote au Mont-Saint-Michel. Les racines grecques de l’Europe chrétienne », Cahiers de civilisation médiévale, 202 | 2008, 182-184.
Référence électronique
Jacques Verger, « Sylvain Gouguenheim. – Aristote au Mont-Saint-Michel. Les racines grecques de l’Europe chrétienne », Cahiers de civilisation médiévale, 202 | 2008, mis en ligne le 01 septembre 2025, consulté le 29 janvier 2026. URL : http://journals.openedition.org/ccm/27404 ; DOI : https://doi.org/10.4000/14o7q
- Tolède fut reprise aux Arabes par Alphonse VI en 1085. [↩]






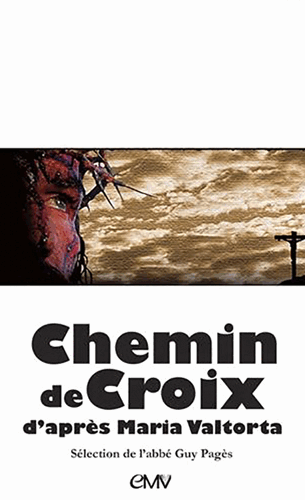









Derniers commentaires