La conversion de Constantin et la christianisation de l’empire romain
par Yves Modéran (1955-2010)
Professeur à l’Université de CaenVersion pdf publiée dans Historiens & Géographes n° 426
Version traitement de texte (relue avec l’aide de Chantal Adigard)
Ce texte correspond au contenu de la conférence faite par Yves Modéran
pour la Régionale de l’APHG en juin 2001.
Le texte a été fourni par Yves Modéran en 2004.
L’auteur a publié ensuite
L’Empire romain tardif, 235-395, éd. Ellipses, Paris, 2003
Les Maures et l’Afrique romaine, IVe-VIIe siècle, EFEAR, 2004
Je voudrais ici, non pas traiter de la christianisation de l’empire romain dans la globalité du sujet, mais poser la question de la chronologie : quand l’empire romain est-il vraiment devenu chrétien ?
Cette interrogation est une des plus anciennes qui soient en histoire romaine comme en histoire religieuse, et si je la relie à la conversion de Constantin, c’est parce que depuis toujours cet événement a été placé au centre de la réflexion des historiens, soit pour en faire un quasi-point de départ, soit au contraire pour en faire un aboutissement symbolique.
Pour toute une école historiographique catholique, très longtemps dominante et encore très présente, l’adhésion de Constantin à la religion du Christ fut en effet un événement important dans l’histoire de l’Eglise, mais pas un tournant absolument révolutionnaire : ce fut, disent ces historiens, une étape dans un processus continude conquête du monde, qui avait commencé depuis la Pentecôte, et qui, au début du IVe siècle, était déjà très avancé, tant numériquement que socialement ; en clair, n’hésitent-ils pas à dire, en 312, avant même la conversion de l’empereur, la partie était déjà gagnée face au paganisme. Le tournant capital aurait été le IIIe siècle, qui vit une formidable accélération des conversions, dans le peuple et déjà dans les élites. Dans cette logique donc, le ralliement de Constantin en 312 n’aurait été qu’un couronnement, et non une révolution.
C’est par exemple la position du cardinal Daniélou dans la Nouvelle histoire de l’Eglise parue au Seuil en 1963, récemment rééditée dans la collection de poche “Points” : “Au début du IVe siècle”, écrit-il, les forces vives de l’empire étaient en grande partie chrétiennes… En dégageant l’empire de ses liens avec le paganisme, Constantin ne sera pas un révolutionnaire. Il ne fera que reconnaître en droit une situation déjà réalisée dans les faits.
Certes, reconnaissait-il aussi, après d’autres, la conversion totale des masses, surtout dans les campagnes, prit encore beaucoup de temps, parfois plusieurs siècles, et parfois sans jamais être parfaite. Pour ces ” attardés “, l’usage du bras séculier fut bien utile et accéléra l’histoire, mais le fait essentiel reste que le christianisme avait acquis dès avant 312 une position dominante dans l’empire. Du coup, et j’y reviendrai, pour ces historiens, la conversion de Constantin ne représente en fait aucun mystère. La conversion de l’empire suffit à expliquer celle de l’empereur.
Cette thèse n’a jamais fait l’unanimité, mais on ne lui a longtemps opposé qu’une critique purement négative, sans véritable contre-argumentation. Or, depuis une vingtaine d’années, les choses ont vraiment changé grâce à une nouvelle école historiographique, surtout anglo-saxonne mais aussi un peu française, dont les meilleurs représentants sont Alan Cameron et Robin Lane Fox aux Etats-Unis, et Pierre Chuvin et Claude Lepelley en France. L’ouvrage manifeste de cette école, dont je vous reparlerai plusieurs fois au cours de cet exposé, est certainement celui de Lane Fox, Païens et chrétiens, paru en 1986 et qui a été traduit récemment en français. L’originalité de ces chercheurs, qui sont maintenant très à la mode et ont suscité dans les dernières années, en France notamment, une série de thèses en cours ou en voie d’achèvement, c’est de s’être vraiment intéressé, pour lui-même, au paganisme tardif, celui des IIIe et IVe siècle, et dans ce paganisme, d’avoir choisi les cultes les plus traditionnels, ceux qu’on considérait jusque-là comme moribonds, soit parce que le christianisme triomphait, soit parce qu’on considérait qu’il avait été supplanté par les religions orientales, celles d’Isis ou de Mithra notamment. Tous sont partis d’un constat simple et qui aurait dû être fait depuis longtemps : c’est qu’il y a encore un nombre considérable de témoignages des cultes païens au IIIe et même au IVe siècle, littéraires, dans les textes chrétiens qui les dénoncent violemment, et surtout archéologiques et épigraphiques, avec de belles séries de dédicaces, d’ex voto, ou d’attestations de travaux dans les temples qui n’avaient que très peu été étudiés jusqu’ici. Or rien, dit Lane Fox, si ce n’est un préjugé a priori, n’autorise à dire que ces témoignages constituent des formes résiduelles de culte, ou qu’ils correspondent à des actes religieux purement formalistes, dénués de toute véritable piété. Au contraire, et c’est une des parties les plus passionnantes de son livre, il montre que les consultations d’oracles païens sont restées très fréquentes au IIIe siècle, et avec des questions qui montrent une véritable angoisse, à laquelle on croyait que les dieux traditionnels pouvaient répondre. Sa thèse est donc que ce paganisme tardif était toujours très vivant à la veille de la conversion de Constantin. Et dès lors, conclut-il,c’est le christianisme qui, à la fin du IIIe siècle, était en fait encore un phénomène très minoritaire.
La thèse se veut scientifique, elle est bien étayée, mais il serait très abusif de dire qu’elle a réglé définitivement tous les problèmes. Quand on y regarde de près, et certains l’ont fait aussitôt, on s’aperçoit en effet que ses méthodes se révèlent souvent aussi artificielles que celles des thèses traditionnalistes qu’elle dénonce : comme ses adversaires, Lane Fox s’appuie sur une collection d’exemples pris ici et là, qui sont mis en série de manière déjà arbitraire, et servent ensuite surtout de support à une généralisation qui est très largement hypothétique. Dans les deux cas, le problème essentiel reste en fait celui des sources, qui ne donnent que des vues générales ou des éclairages locaux très ponctuels, aussi bien sur les chrétiens que sur les païens. C’est un problème classique en histoire ancienne, où les instruments statistiques font presque toujours défaut. Mais il est très gênant sur cette question, dont un des enjeux essentiels est justement un problème de chiffres.
Ce qui vient en plus compliquer encore le débat, c’est que des arrières pensées d’ordre plus ou moins idéologiques affleurent encore bien souvent derrière les travaux de tous ces spécialistes modernes du christianisme antique. Le travail de Lane Fox se prête aisément à la critique, mais ceux qui l’attaquent ne le font pas toujours au nom de la seule vérité scientifique. Ce qui hérisse en particuliers certains historiens cléricaux, ce sont les conséquences plus ou moins implicites de sa conclusion. Si en effet les chrétiens n’étaient qu’une petite minorité en 312, alors il faut forcément admettre que l’évangélisation des masses et des forces vives de l’empire, comme disait le cardinal Daniélou, a été un phénomène postérieur ; et du coup il devient difficile de dissocier ce phénomène de la conversion de Constantin et de la transformation du christianisme en religion d’Etat. Si on suit Lane Fox, la tentation est effectivement grande de conclure que c’est la conversion de Constantin et de l’Etat romain, avec tous les moyens de séduction ou de contrainte qu’il mit en place à terme, qui expliquerait le triomphe final de l’Eglise à la fin de l’Antiquité. En un mot, la conversion de Constantin, de conséquence, deviendrait ainsi plus ou moins la cause de la christianisation de l’empire.
D’un point de vue purement scientifique, l’hypothèse n’a évidemment rien de scandaleux, mais elle passe mal chez certains, parce qu’ils la ressentent toujours un peu comme une attaque : ils supportent mal l’idée que la religion du Christ ne se serait pas imposée d’elle-même dans le monde romain, par ses propres vertus et sa supériorité naturelle, mais seulement parce qu’elle devint au cours du IVe siècle religion d’Etat. Tout le miracle de la petite secte née en Palestine et conquérant le monde par la parole de ses fidèles, qui en fait reste très cher à toute une tradition historiographique, leur paraît s’effondrer du coup.
Certes, personne ne dit les choses de façon aussi brutale, mais, à mon sens, cet aspect idéologique, de manière inavouée et parfois inconsciente, est bien en fait derrière beaucoup des débats actuels. Car la thèse traditionnelle, avec des atténuations, est encore souvent énoncée : la dernière manifestation en date se trouve probablement dans le chapitre sur Constantin rédigée par Aline Rousselle dans le volume sorti en 1999 de la Nouvelle histoire de l’Antiquité sur le Bas-Empire dans la collection “Points” au Seuil, où on lit que “les chrétiens étaient une puissante minorité présente dans des lieux et positions clés (en 312). “Puissante minorité” est une expression qui est loin de faire l’unanimité.
C’est donc à la fois un vieux et vaste problème toujours d’actualité que cette question des causes et des effets de la conversion de Constantin, et qui est encore compliqué, j’y reviendrai tout à l’heure, par les incertitudes sur les modalités et la chronologie de cette conversion elle-même. Vouloir le traiter en une heure ne serait évidemment pas réaliste, et m’entraînerait aussi à énoncer certainement nombre de choses que vous savez déjà. Aussi vais-je surtout essayer ici de vous indiquer, après les inévitables rappels des faits, l’état de nos connaissances et ce qui paraît être surtout l’apport le plus solide des débats en cours. Pour rester neutre par rapport à la querelle qui est derrière ces débats, je présenterai d’abord ce que l’on sait des chrétiens au IIIe siècle. J’aborderai ensuite la fameuse “question constantinienne” comme disent les Allemands, celle de la date et des causes directes de la conversion ; et je finirai en résumant les principales questions qui se posent sur les modalités, les causes et le rythme du processus de christianisation au IVe siècle, après Constantin.
A) Les chrétiens au IIIe siècle
Que sait-on donc d’abord exactement du nombre et de l’importance des chrétiens au début du IVe siècle, lorsque se déclenche la dernière grande persécution, celle de Dioclétien en 303 qui précède immédiatement la conversion de Constantin ?
Nous avons vu le point de vue de Daniélou, qui admet une évangélisation avancée, qui aurait gagné largement déjà les élites. En face, Lane Fox estime la part des chrétiens, en 312, à 4 à 5 % seulement de la population totale de l’Empire, ce qui ferait d’eux une petite minorité.
1) L’écart est considérable, aussi bien dans l’évaluation globale que pour ce qui concerne la physionomie sociale des communautés chrétiennes, et il importe donc de voir sur quoi il se fonde, ce qui nous amène en fait à poser directement le problème des sources.
Elles sont de trois types.
– a) Traditionnellement, en histoire romaine, on privilégie d’abord les inscriptions, et notamment les dédicaces et les épitaphes, considérées dit-on souvent comme les seuls véritables documents d’archives légués par la civilisation romaine (en dehors des papyri égyptiens). Le problème est que pour ce qui concerne l’histoire de la christianisation avant 312, elles sont fort rares. Pour le IIIe siècle, la seule région, en dehors de Rome à en livrer est l’Asie Mineure centrale, plus précisément la province de Phrygie, et elles sont au total peu nombreuses. Ce sont des inscriptions funéraires des années 240-280, sur lesquelles le défunt a ajouté à son nom la mention “chrétien”. On y voit quelques notables locaux, preuve qu’ici l’Eglise était sortie des milieux populaires, mais cela ne nous apprend rien sur leur représentativité dans la population. Et ailleurs donc, en dehors de la capitale, c’est le désert : En Afrique par exemple, où l’on a par ailleurs tant de documents, aucune inscription chrétienne n’est de manière certaine antérieure à Constantin.
– b) Les sources littéraires sont heureusement plus nombreuses. Elles ont longtemps servi d’arguments aux tenants d’une christianisation massive au IIIe siècle. La tendance, et elle est scientifiquement irréprochable, est aujourd’hui de s’attacher à la lettre à ce qu’elles disent, sans extrapolations, c’est-à-dire sans généraliser à une province une information donnée seulement pour une ville. Mais si cette méthode permet de réels progrès, elle aboutit aussi, on le devine, à parcelliser à l’extrême nos connaissances.
-* De toutes ces sources, les moins précises sont les histoires ecclésiastiques, toutes écrites après la conversion de Constantin. La plus fiable, parce que l’auteur cite et reproduit parfois ses sources, est celle d’Eusèbe de Césarée, qui est aussi la plus ancienne, écrite en 313 et plusieurs fois remaniée ensuite. On y trouve quelques indications sur l’état des communautés au début du IVe siècle, mais très vagues, et en fait seulement pour l’Orient.
_* Plus utiles sont les vies de saints, qui parfois décrivent des opérations d’évangélisation dans les villes ou les campagnes avec des détails précis et vérifiables. Ces textes sont cependant difficiles à utiliser parce que plus ou moins légendaires. Les études critiques récentes en ont cependant réhabilité beaucoup, les plus prisés étant ceux qui ont été rédigés par un contemporain du saint, par exemple la vie de saint Cyprien de Carthage par son diacre Pontius vers 260.
_* Plus utiles encore sont les passions de martyrs, surtout quand elles reprennent simplement les actes des procès. Ici aussi, ces textes sont surtout intéressants par ce qu’ils révèlent des situations locales. Ils ne permettent pas de généralisations mais ont parfois un peu valeur de sondage pour une cité ou un secteur donné. Ainsi notamment certaines passions de martyrs africains des années 303-305, dont nous avons des actes judiciaires authentiques. Le dernier en date, qui a été découvert tout récemment, en 1996, par un philologue italien dans un manuscrit provenant d’Aquilée, en Italie du Nord, est le texte du martyr de Gallonius de Thimida Regia, une petite cité de Tunisie bien connue aujourd’hui : c’est simplement la copie, entourée plus tard d’une introduction et de considérations complémentaires, du procès-verbal de comparution des chrétiens de cette cité en 303 devant le tribunal du proconsul d’Afrique.
_* Mais les documents les plus extraordinaires du genre, qui sont aussi nord-africains, sont les archives du schisme donatiste. Ce schisme est né après la persécution en 305, lorsque s’est posé le problème de la réintégration dans l’Eglise de ceux qui avaient cédé aux persécuteurs : certains irréductibles ont refusé cette réintégration et ils ont constitué une Eglise séparée, l’Eglise des purs, sous la conduite d’un certain Donat. L’important pour nous est que l’affaire a pris une tournure judiciaire sous Constantin, lorsque l’Etat chrétien s’en est mêlé. Constantin voulait savoir en effet qui avait raison, et il a en particulier fait faire une enquête en 320 en Numidie par son gouverneur, Zenophilus. Il est apparu alors que certains donatistes, dans la capitale provinciale elle-même, Cirta, avaient menti et avaient eux-mêmes failli lors de la persécution. L’enquête aboutit à mettre au jour en particulier un document retrouvé dans les archives municipales de la ville,
le procès-verbal des perquisitions effectuées dans l’Eglise de Cirta le 19 mai 303, où apparaissaient bien le comportement des uns et des autres face à la police romaine. Or ensuite le dossier de cette enquête a été plusieurs fois recopié par les polémistes catholiques, car le schisme a duré jusqu’au Ve siècle et même au-delà. Optat de Milev, et surtout saint Augustin, qui a consacré beaucoup de son énergie et de nombreux traités à combattre les schismatiques, le citent souvent. Du coup, au Moyen Age, en France, en Espagne et en Italie principalement, lorsqu’on copia et recopia les œuvres d’Optat et d’Augustin, on s’est intéressé aussi aux autres textes anti-donatistes, et c’est ainsi, par chance, qu’un manuscrit, du IXe siècle, qui est aujourd’hui à la BN, a conservé, à la suite d’un traité d’Optat, ce texte extraordinaire, une véritable pièce d’archive policière du temps de Dioclétien. Je vous ai reproduit, dans une vieille traduction malheureusement et je m’en excuse, ce document qui, je crois, est encore assez peu connu.
On y trouve de nombreux chiffres qui permettent quelques réflexions : pour une ville qui était la capitale de la province de Numidie, et qui d’après les archéologues devait avoir peut-être de 20 à 30 000 habitants, il n’y avait qu’une “maison” des chrétiens. Les effectifs du clergé s’élevaient, à lire ce texte qui n’en oublie certainement aucun, en tout à 24 membres, dont un évêque et quatre prêtres. Rapporté à ce que l’on sait par d’autres documents, à Rome notamment, du taux d’encadrement des fidèles, cela donnerait au grand maximum une communauté de 3 à 5000 fidèles, c’est-à-dire au mieux encore, entre 10 et 20 % de la population. Mais l’estimation est sûrement trop haute, surtout quand on regarde le stock de vêtements découvert, qui devait probablement correspondre à ce qui était distribué aux nécessiteux, un peu plus d’une centaine seulement. Ce chiffre des vêtements est surtout intéressant par la disproportion qu’il révèle entre hommes et femmes : 82 tuniques de femmes contre 35 tuniques ou capes pour hommes, soit plus de double de femmes. Et la proportion est encore plus grande quand on considère les chaussures : 47 paires féminines contre 13 masculines. D’une manière ou d’une autre, qu’on considère les donateurs ou les récipiendaires, tout cela suggère une nette suprématie des femmes dans la communauté chrétienne de Cirta, ce qui est précisément ce que dénonçaient au IIIe siècle, de manière générale, les polémistes antichrétiens, qui parlaient d’une ” religion de bonnes femmes “…
On a là un élément solide sur lequel s’appuyer, et qui donnerait plutôt raison à Lane Fox, même sur le plan social : car le texte cite bien quelques individus de condition notable parmi les membres du clergé, mais rien d’exceptionnel. Le plus éminent est le grammaticus Victor, un professeur de l’enseignement secondaire. Il devait y avoir cependant des gens aisés parmi les simples fidèles, puisque le trésor de l’Eglise contient quand même un certain nombre d’objets en or et en argent. Mais on est loin des forces vives de Daniélou ! Or tout indique que l’Afrique du Nord est certainement à l’époque, et de loin, en Occident la région où la christianisation était la plus avancée.
– c) La meilleure preuve de cette avance vient du troisième et dernier type de documents signalés précédemment, souvent considérés a priori comme les seuls vraiment significatifs, les listes épiscopales. Ce sont en fait aussi des pièces d’archives, mais des archives ecclésiastiques, dont la conservation s’explique beaucoup mieux. L’Eglise a toujours eu le souci en effet, dans l’Antiquité, de garder et de faire recopier régulièrement les actes de ces assemblées d’évêques, parce que pendant très longtemps le pouvoir de fixer les règles et le dogme n’appartenait qu’aux conciles, conciles régionaux surtout jusqu’en 325, puis à partir de la fameuse assemblée de Nicée, conciles œcuméniques. Il faut rappeler ici que l’autorité des papes, qu’il vaudrait mieux appeler évêques de Rome, est restée surtout de pur prestige jusqu’à la deuxième moitié du IVe siècle, et qu’elle n’est véritablement devenue souveraine en fait qu’à partir de Léon le Grand vers 450. Or l’usage était, à la fin de chaque séance des conciles, de faire signer les évêques présents avec la mention du nom de leurs sièges. Nous avons conservé quelques actes de conciles régionaux, surtout en Afrique, et les listes également de deux conciles généraux du début de l’ère constantinienne, celui d’Arles en 314 et celui de Nicée en 325, qui nous donnent au total une vue assez précise de l’épiscopat chrétien au début du IVe siècle.
On constate d’abord de très grandes inégalités d’une région de l’empire à l’autre.
Quatre secteurs ont un épiscopat nombreux, ce qui suppose a priori une christianisation plus avancée : l’Asie Mineure, avec 98 à 102 évêques, le bloc Syrie-Palestine, avec 75 évêques, l’Egypte, avec entre 70 et 100 évêques, et tout en haut l’Afrique du Nord, qui compte alors entre 200 et 250 évêques.
Face à cela, d’autres régions semblent gravement sous encadrées : l’Italie : 25 évêques; la Gaule: une trentaine ; l’Espagne, une vingtaine ; la Bretagne, entre trois et six…
On peut considérer qu’on se trouve là sur un terrain solide, et conclure au moins à une christianisation à peine commencée dans tout ce deuxième groupe de provinces, toutes occidentales. Ici assurément, ce n’est même pas de 5 % qu’il faudrait parler, mais peut-être de 1 à 2 % de chrétiens en 312…
– La question de la signification d’un fort encadrement épiscopal en Orient et en Afrique est plus délicate. Les historiens comme Daniélou estiment que 70 à 100 évêques pour un pays comme l’Egypte, ou 250 pour l’Afrique du Nord impliquent nécessairement que la majorité des habitants de ces régions étaient alors convertis. Le problème, et il a été souligné par d’excellents savants catholiques comme Charles Piétri, est que les normes de constitution de l’épiscopat dans l’Antiquité étaient très différentes de ceux qu’elles sont devenues ensuite. A l’époque, le principe est que chaque cité où réside une population chrétienne a droit à un évêque, quelle que soit la taille de la cité. La norme ne se définit pas sur un critère démographique, mais sur un critère politique, au sens premier du terme, fondé sur la notion de polis. La cité pour les Romains comme pour les Grecs était en effet la cellule indispensable d’intégration des communautés humaines : tout homme libre devait dans l’idéal être citoyen d’une cité, ce que Cicéron appelait sa petite patrie, par rapport à la grande patrie romaine. Dans ces conditions, ce que reflète surtout le nombre des évêques, c’est en fait le nombre des cités d’une province : son taux d’urbanisation bien plus que son taux de christianisation. Et de fait, dans le cas africain, l’archéologie a bien montré que le nombre des cités atteignait ici une densité extraordinaire, plus de 500 en tout, qui s’égrenaient parfois, dans l’actuelle Tunisie, tous les 5 ou 6 kilomètres. Que le pays ait eu alors environ 250 évêques prouve que l’Eglise était présente dans au moins la moitié des cités, mais ne nous apprend rien sur le nombre total des chrétiens.
C’est sur ce point qu’il est particulièrement intéressant, cependant, de revenir aux données des vies de saints, des actes des martyrs, et du dossier du donatisme. Car ce qu’on voit alors, comme à Cirta, c’est que dans une grande cité comme cette capitale provinciale l’Eglise avec son évêque ne possédait apparemment qu’une basilique et réunissait au mieux quelques centaines de fidèles, assurément moins de 10 % de la population. Transposé à l’échelle du pays, ce chiffre relativise beaucoup l’impression laissée par les actes conciliaires…
Le dossier de nos sources sur cette question de la christianisation de l’empire avant Constantin, on le constate, est donc loin encore de permettre des évaluations sûres.
Quelques conclusions semblent néanmoins maintenant à peu près acquises :
– La première, c’est l’inégalité flagrante de cette christianisation selon les régions. Le retard de la Gaule en particulier est certain et admis en fait de tous, et pas seulement à cause des listes épiscopales. Les indices indirects sont très nombreux et tous convergent. A un degré moindre, la situation est la même en Espagne et en Italie, mais avec en plus de fortes inégalités internes : en Espagne, le sud, la Bétique, abrite en effet presque tous les évêques connus ; et en Italie Rome est à part, avec dans la ville un clergé nombreux, plus de 150 personnes dès 250, ce qui conduit à supposer un peu moins de 10 %, peut-être, de chrétiens dans la ville en 312. En face, nous trouvons donc l’Afrique, et les provinces d’Orient, la Syrie, l’Asie Mineure, l’Egypte, qui ont été les premiers foyers du christianisme et ont gardé une avance.
– Mais jusqu’à quel point ? Dans un livre très récent, paru en 1993, consacré à l’Egypte dans l’Antiquité tardive, et qui est vraiment excellent, un historien américain,Roger Bagnall vient d’avancer le chiffre de 20 % de chrétiens en 312, en partant des données d’un quatrième type de sources, qui est propre à cette province, et que je n’ai pas évoqué, les papyrus. Nous possédons en effet de grosses collections, sous cette forme, d’archives de cités égyptiennes pour les IIIe et IVe siècles, et Bagnall, en recoupant de multiples critères directs et indirects d’identification des chrétiens, est arrivé à ce chiffre pour plusieurs cités. Il le généralise peut-être un peu abusivement, mais il est plausible. Peut-on aller plus loin encore en Asie Mineure, là où Pline le Jeune disait dès 112 que les chrétiens se multipliaient dangereusement ? Certains le croient et avancent une proportion d’1/3, ce qui n’est pas impossible. Nous avons vu qu’en Afrique 10 à 20 % seraient aussi possibles. Dans ces trois régions, on pourrait parler comme Aline Rousselle de “puissante minorité“, mais elles ne représentaient qu’une partie géographique elle-même minoritaire de l’empire…
Impossible donc, au total, de se lancer dans une évaluation globale, mais il est clair que toutes les recherches actuelles, on le voit, font quand même pencher nettement plus la balance dans le sens de Lane Fox que dans celui de Daniélou. Il suffit d’ailleurs pour s’en rendre compte de lire les chapitres de Charles Piétri dans la dernière grande synthèse en date, le tome II de la l’Histoire du Christianisme des éditions Desclée sorti en 1995. Piétri lui-même était un catholique convaincu et les éditions Desclée n’ont jamais eu de complaisance pour l’anticléricalisme. Or les conclusions du livre sont sans équivoque : en 312, les chrétiens n’étaient assurément qu’une minorité dans l’empire, et je doute franchement qu’on puisse maintenant revenir sur cette idée.
– Cela dit, le problème du nombre est une chose, mais il faudrait aussi ne pas perdre de vue le problème du rythme de la christianisation. A force de se pencher sur la situation à un moment donné, on oublie souvent en effet de regarder l’allure de la courbe qui précède ce moment. Or, là, les conclusions diffèrent un peu et sont plus favorables aux historiens de l’ancienne école. Il est clair en effet que la christianisation, tout en n’atteignant pas des seuils élevés, a quand même beaucoup progressé au cours du IIIe siècle, et surtout après 250-260. Les listes d’évêques ici sont quand même très révélatrices, quelles que soient les limites qu’on leur apporte. L’exemple de l’Egypte, le mieux documenté, est clair sur ce point : 1 évêque vers 192, 4 vers 220, 25 vers 250, entre 70 et 100 vers 300. Même si encore une fois chacun ne dirige que quelques milliers de fidèles, la diffusion de la nouvelle religion est quand même très spectaculaire. Et cette impression se vérifie partout. Sur la longue durée, à l’échelle de l’ensemble de l’empire, cela oblige à conclure que si pendant près de deux siècles, jusque vers 180-200, le christianisme, sans végéter complètement, est longtemps resté au niveau d’une secte très minoritaire, obscure, confinée aux milieux les plus modestes de la société, et donc de peu d’importance sauf en quelques secteurs comme l’Asie Mineure ou Rome, il s’est au contraire répandu partout au cours du IIIe siècle.
– Parallèlement, on voit bien aussi, par de multiples indices qu’il a commencé à la même époque à sortir des milieux plébéiens et à progresser au sein des élites. Au moment de la conversion de Constantin, on cite souvent comme l’indice le plus sûr de ce phénomène un document chrétien : ce sont les actes du concile d’Elvire en Espagne (309 ?), où les évêques locaux discutèrent du cas des chrétiens qui étaient en même temps magistrats municipaux dans leurs cités, et à ce titre amenés à des compromissions, de par leur charge, avec les rites du culte public païen. Même dans cette région, où le christianisme globalement était encore très minoritaire, le milieu des notables urbains était donc gagné. Mais nous savons aussi qu’il y avait des chrétiens dans la haute aristocratie depuis au moins le milieu du IIIe siècle. L’édit de persécution de Valérien en 258 le dit d’ailleurs explicitement, puisqu’il contient une rubrique spécifique pour les sénateurs et chevaliers chrétiens. On a longtemps douté de la réalité de cette implantation au sommet de la société, mais tout récemment, en 1995, un des plus grands spécialistes actuels du Bas-Empire, Timothy Barnes, vient de montrer par une étude prosopographique très fine qu’il existait très vraisemblablement en 312, à Rome même, un clan de familles sénatoriales christianisées.
Le rythme de progression de l’évangélisation avait donc bien changé depuis le milieu du IIIe siècle, mais ce phénomène admis, les deux conclusions précédentes n’en restent pas moins valables : à savoir l’inégalité très forte de la christianisation d’une province à l’autre, et surtout le caractère encore globalement très minoritaire des chrétiens dans l’empire.
à D’où maintenant un retour à la question classique, désormais peut-être encore un peu plus obscure : Comment, dans ces conditions, comprendre la conversion de Constantin, qui de quelque manière qu’on l’aborde, apparaît a priori de plus en plus comme un acte d’une extraordinaire audace ?
B) La question constantinienne
– 1) a) Avant d’aborder les explications de cette conversion, il faut cependant s’entendre sur ses modalités et sa chronologie, et là aussi, rien en fait n’est vraiment clair. La seule date certaine, c’est celle de son baptême, peu avant sa mort, en 337. En théorie, ce devrait être aussi celle de sa conversion officielle. Mais dans l’Antiquité, et on le vit à de nombreuses reprises jusqu’au Ve siècle, les hommes publics, et notamment les militaires, eurent très souvent l’habitude de se faire baptiser sur leur lit de mort, alors même qu’ils étaient chrétiens depuis longtemps. Ceci tout simplement parce qu’on pensait que le baptême seul effaçait toutes les fautes, et qu’il valait donc mieux être ainsi purifié juste avant de comparaître devant le juge suprême. La date de 337 ne signifie donc pas grand-chose, et de fait de nombreux indices prouvent que Constantin était devenu chrétien avant. Mais quand ?
– b) Ici une autre certitude est acquise : pas depuis sa naissance. Son père Constance Chlore, un des quatre empereurs de la tétrarchie entre 293 et 306 ne l’a jamais été, et sa mère, la future saint Hélène, semble ne l’être devenue qu’après lui. On sait d’autre part qu’il a été élevé à la cour de Dioclétien jusqu’en 305 et qu’il a été associé à tous les rites païens officiels à ce moment. Surtout, ses monnaies, et les panégyriques qui lui sont dédiés de son avènement en 306, où il ne contrôle que la Bretagne, l’Espagne et la Gaule, jusqu’en 312, moment de la conquête de l’Italie, comportent tous des références païennes explicites qui ne laissent aucun doute. La rupture pour ce qui le concerne se situe donc entre 312 et le début des années 330.
– 2) Mais si on essaie de préciser à partir de là, les problèmes deviennent beaucoup plus compliqués et obligent aussi à poser la question des modalités et de la nature exacte de sa conversion. Toute la difficulté tient ici fondamentalement à nouveau à un problème de sources, et de fait, tous les travaux récents ont précisément été des études nouvelles sur les sources.
Si on part des textes d’abord, on se trouve face à trois traditions différentes, une tradition chrétienne, une tradition païenne officielle, et une tradition païenne clandestine.
— a) La tradition chrétienne est la mieux connue, c’est celle qu’ont popularisée notamment depuis un siècle et demi tous les manuels de l’enseignement catholique, et elle repose avant tout sur un texte, La vie de Constantin attribuée à Eusèbe de Césarée, dont est reproduit en annexe le passage essentiel. C’est le fameux récit de la vision de Constantin en 312, peu avant la bataille du Pont Milvius et la prise de Rome, qui aurait entraîné une conversion immédiate et complète de l’empereur. Le texte est célèbre, il est édifiant, et du coup, comme les apparitions de Jeanne d’Arc, il a toujours hérissé une certaine historiographie laïque. Les historiens ont cependant essayé de l’examiner de manière rationnelle, et tout leur travail pour cela a d’abord été de déterminer l’auteur de la vie de Constantin et la date de rédaction de l’oeuvre. Jusqu’il y a une quarantaine d’années, sous l’influence notamment d’un chercheur belge, Henri Grégoire, la tendance était plutôt à considérer le livre comme un apocryphe d’Eusèbe, rédigé à la fin du IVe siècle, avec une trame purement légendaire. Mais il faut dire que peu de gens avaient lu en fait la Vie de Constantin, rédigée en grec et quasiment jamais traduite dans une langue moderne, et que Grégoire et ses disciples étaient aussi plutôt marqués par un anticléricalisme de principe. Aujourd’hui, les choses ont bien avancé et, à la suite des travaux d’une équipe anglo-américaine, Averil Cameron vient de publier, en 1998, une traduction commentée en anglais avec une introduction critique qui fait vraiment bien le point. Sa conclusion est que le texte est bien d’Eusèbe, qui fut après 325 un proche de Constantin, et que sa composition finale eut lieu peu après la mort de l’empereur, en 337 ou 338.
– Cela redonne du poids à la tradition de la vision et de la conversion en 312, mais pas autant que les recherches récentes sur un second pilier de celle-ci, le livre deLactance sur La mort des persécuteurs. Alors qu’on connaît Eusèbe par un nombre assez important de manuscrits, étudiés depuis très longtemps, le livre de Lactance, lui, ne nous est parvenu que par un seul codex, qui n’a été découvert qu’à la fin du XVIIe siècle dans la bibliothèque de l’Abbaye de Moissac, dans le Tarn et Garonne. C’est le Colbertinus 2627, qui est aujourd’hui à la BN, et qui lui, ouvrons ici une parenthèse, n’a pas été trouvé par hasard : c’est Colbert qui, pour sa propre bibliothèque, avait en 1678 lancé un de ses hommes, le comte de Foucault, pour fouiller ce monastère bénédictin, à l’époque encore occupé mais très mal géré, où on soupçonnait qu’il pouvait y avoir des manuscrits d’œuvres inconnues. L’idée était bonne puisqu’on sait que Foucault finit par sortir d’une réserve 250 manuscrits d’un coup, dont notre Lactance sur un codex du XIe siècle, qui contenait aussi d’autres œuvres, des vies de saints, des extraits de Grégoire de Tours et de saint Jérôme, et même une liste de redevances dues à l’abbaye de Moissac.
Ce fut une découverte capitale parce que Lactance est un auteur qui était par ailleurs bien connu. C’était lui aussi un contemporain de Constantin, qui devint le précepteur de son fils, et on savait depuis longtemps, par un catalogue de ses œuvres composé par saint Jérôme à la fin du IVe siècle, qu’il avait écrit ce livre. Dans son cas, le problème de l’authenticité ne se posait donc pas. Ce qui par contre a fait difficulté, et a suscité jusqu’aujourd’hui de nombreuses recherches, c’et la date de composition du traité sur La mort des persécuteurs. La question est importante parce que dans un passage, ici reproduit en annexe, il évoque lui aussi une vision de Constantin en 312, peu avant la prise de Rome, comme Eusèbe de Césarée. Or les travaux récents de T. Barnes aboutissent aujourd’hui à dater son texte de 314 ou 315, soit peut-être moins de deux ans après la prise de Rome. Du coup, on le voit, on arrive maintenant à une conclusion assez solide, et qui n’était pas du tout évidente il y a encore trente ans : qu’on se prononce ou non sur la réalité de la vision, il est clair que, du point de vue chrétien, le Christ avait choisi l’empereur dès 312. Et on imagine mal, étant donné l’excellence des relations de l’Eglise avec Constantin dès ce moment, qu’elle ait répandu cette interprétation sans l’accord du pouvoir.
– b) Face à cela, que dit l’historiographie païenne ? Elle se subdivise en deux traditions.
Celle que j’appelle officielle est représentée surtout par les panégyriques lus devant l’empereur lors de fêtes solennelles, dont nous possédons cinq exemplaires différents datés de 307, 310, 311, 313 et 321. Aucun ne parle d’une conversion, mais on note un net changement entre les trois premiers, d’avant octobre 312 et les deux suivants. Le panégyrique de 310 exalte notamment la dévotion de Constantin pour Apollon, explicitement nommé, et il raconte même une première vision de Constantin, païenne, dans un temple du Dieu en Gaule. Au contraire, dans le panégyrique de 313, il n’est plus question que de la protection sur l’empereur d’une Divinité mystérieuse qui l’a incité à combattre malgré les réponses négatives des haruspices. Aucun Dieu païen n’est plus nommé, et on a vraiment l’impression d’être en face d’un exercice d’acrobatie rhétorique réalisée par un rhéteur qui est lui-même païen, et s’efforce, par le flou du vocabulaire, d’évoquer le changement religieux du souverain sans renier ses propres convictions.
C’est de toute évidence à ce texte de 313 qu’il faut relier un document épigraphique très célèbre,la dédicace du fameux arc de Constantin toujours en place aujourd’hui à Rome, tout près du Colisée. Le monument date en effet de la même époque, le chantier a commencé en 313 et l’inauguration a eu lieu en 315. On peut le considérer comme un témoignage de la tradition païenne officielle lui aussi, car légalement, comme le dit le texte, c’est le sénat romain qui l’a fait construire. Or, même si avec Barnes on reconnaît en 312 la présence de sénateurs chrétiens, ils n’étaient qu’une infime minorité dans l’assemblée. Le sénat était païen à ce moment, païen mais prudent dans une ville impériale désormais. D’où cette formulation vague de la ligne 3, la ligne clef : Quod instinctu divinatis rempublicam ultus est = parce que sous l’inspiration de la Divinité il a vengé l’Etat. Cette Divinitas imprécise, c’est assurément ce nouveau Dieu de Constantin que les païens évitent de nommer en le désignant par un mot neutre, mais qui est au singulier.
– c) Ce procédé est en revanche impossible avec la 3e tradition, celle que j’ai appelée la tradition païenne clandestine. Celle-ci repose en fait sur un auteur tout à fait exceptionnel, Zosime, dont sont reproduits en annexe, à la suite, quelques extraits. C’est un Grec qui vivait à Constantinople à la fin du Ve siècle, et qui, de manière secrète évidemment à cette époque, était resté païen. Il nous a laissé une histoire romaine qui est en général précise et assez sûre, parce qu’il s’est contenté, en fait, de résumer ou de recopier pour chaque période antérieure des historiens eux-mêmes de grande qualité. Dans le cas du règne de Constantin, sa source est un certain Eunape, païen lui-même, qui vivait au début du Ve siècle et avait écrit une histoire romaine aujourd’hui perdue. Or Eunape et Zosime ont une image de Constantin, on peut s’en rendre compte à partir des extraits reproduits, qui n’a vraiment rien de commun avec celle des auteurs analysés précédemment. Ils ne disent rien d’une conversion en 312. Pour eux, Constantin n’est passé au christianisme que bien plus tard, en 326, après avoir commis deux crimes horribles, et qui sont par ailleurs sûrs, le meurtre de son fils aîné Crispus, puis celui de sa seconde femme Fausta. Pris de remords, l’empereur n’aurait alors trouvé de réconfort que chez les prêtres chrétiens, toujours prêts à tout pardonner, et il serait devenu chrétien.
L’épisode n’est, dans le livre de Zosime, qu’un aspect de ce qui entend être, du début à la fin, un portrait à charge de Constantin, rendu responsable, en fait, de tous les malheurs de l’Empire et de l’effondrement final de l’Occident romain au Ve siècle. Cette hostilité absolue au premier empereur chrétien a longtemps fait de Zosime un auteur maudit. Un seul manuscrit de son oeuvre a en effet survécu, le Vaticanus Graecus 156, conservé à la Bibliothèque du Vatican, dont les vicissitudes ont été nombreuses. Copié dans des conditions mystérieuses au Xe siècle dans un grand couvent de Constantinople, le Stoudios, en même temps qu’une oeuvre de Lucien fort peu amène pour les chrétiens, on ne sait ni quand (peut-être en 1453 ?) ni comment il est arrivé en Italie. Il avait, en tout cas, déjà été malmené puisqu’il lui manquait certaines pages, et surtout un cahier entier, celui qui devait être consacré à Dioclétien : lacune certainement non accidentelle car Zosime devait dire trop de bien de cet empereur persécuteur… Il fut oublié ensuite dans les réserves de la Vaticane jusqu’à ce qu’un humaniste curieux ne le redécouvre en 1475 et en obtienne le prêt. Connu de quelques érudits qui le firent copier et en préparèrent une édition, il finit alors par attirer l’attention de l’Eglise. Ce fut un scandale, et le manuscrit fut récupéré. Finalement, en 1572, Pie V en interdit officiellement la lecture et le fit placer dans l’enfer de la bibliothèque. Il n’en ressortit qu’en 1820 et il fallut attendre 1887 pour en avoir enfin une édition complète. C’est dire si le sujet était brûlant, et notamment, on le voit dans les textes du XVIe siècle, à propos des passages sur Constantin.
Tout cela nous rendrait, il faut le dire, Zosime plutôt sympathique, mais si nous revenons maintenant à notre sujet, je crois qu’il faut quand même sur le fond ne pas céder ici à cette tentation. Le fanatisme n’est pas seulement une déviance des religions monothéistes. Il y a eu aussi des païens fanatiques, et Zosime en était un à sa manière. Il hait véritablement Constantin, ce qui a l’avantage pour nous de prouver que pour les gens du temps, c’était bien sa conversion qui était perçue comme la cause essentielle de la christianisation de l’empire. Mais en même temps, il est clair aussi que cette haine n’est pas un gage de sûreté historique. Elle a pu l’amener sciemment à déformer les faits, pour ternir au maximum l’image de l’empereur renégat. Dans ces conditions, et je résume ici l’avis de l’éditeur et commentateur le plus récent de Zosime, François Paschoud, on ne peut sérieusement espérer contrebalancer par son témoignage les affirmations des autres sources sur la conversion de Constantin en 312.
3) C’est cette date donc que tout le monde ou à peu près retient aujourd’hui, sans que cela exclue cependant des discussions résiduelles sur la nature exacte de cette conversion.
Bon nombre d’historiens actuels, en effet, estiment que Constantin a pu, entre 312 et le début des années 320, passer par une phase intermédiaire, en se ralliant au christianisme mais en essayant, dans une perspective syncrétique, de concilier cette adhésion avec un paganisme épuré qui était dans l’air depuis longtemps sous l’influence de la philosophie néo-platonicienne. Cette nouvelle religion à base philosophique, bien attestée dans les années 250-300, faisait émaner tous les dieux traditionnels d’une divinité unique et suprême, La Divinité toutcourt, qu’on identifiait souvent depuis le règne d’Aurélien, dans les années 270, avec le Soleil. Or nous avons vu que certains textes païens, après 312, parlent seulement de cette Divinité, comme aussi la dédicace de l’Arc de Rome. Les historiens de cette école relient à cela le dossier des monnaies de Constantin entre 312 et 325. La numismatique, on le sait, est un vecteur essentiel de la propagande et de l’idéologie impériales à l’époque romaine, c’est même, a-t-on dit, le media par excellence pour le pouvoir. Or, dans cette période 312-325, le monnayage constantinien reste effectivement ambivalent sur le plan religieux : la majorité des types exaltent le soleil, compagnon de l’empereur, ou confondant son image avec lui. Et face à cela, on n’a que peu de monnaies réellement chrétiennes, le type le plus précoce étant celui du médaillon de 315 reproduit en annexe, avec sur le casque, semble-t-il, une reproduction du chrisme, ce signe que Constantin aurait vu lors de sa fameuse vision du Pont Milvius, et une sorte de croix sur l’épaule (ou une épée ?). La conclusion des historiens de cette école est donc que Constantin aurait été, au fond, à la fois chrétien et païen pendant un certain temps, jusqu’à ce qu’il adhère ensuite nettement au christianisme, après la conquête de l’Orient sur son rival Licinius en 324.
C’est une théorie très à la mode encore aujourd’hui, qui est solide, mais qui ne s’impose cependant pas de manière absolue. Si l’on considère l’ensemble de la politique et de la législation constantinienne jusqu’à la mort de l’empereur en 337, force est de constater en effet qu’il a toujours cherché, même après 324, à ménager les païens. Il a gardé toute sa vie le titre de grand pontife, qui lui donnait le contrôle des cultes publics païens, et il a manifesté en général la plus grande tolérance vis-à-vis de toutes les formes de paganisme. Et à sa mort, ses fils ont célébré une quasi apothéose qui rappelait encore de très près les coutumes païennes : la dernière monnaie reproduite dans le dossier annexe montre cette scène étonnante de l’empereur montant au ciel sur son char. Sur les monuments de l’époque d’Hadrien, c’était l’aigle de Jupiter qui enlevait l’empereur. Ici c’est la main de Dieu qui l’accueille.
Tout cela s’explique simplement par un fait que nous avons longuement vu auparavant : au temps de Constantin, l’écrasante majorité des sujets de l’empereur étaient encore païens, et il fallait les ménager, les préparer progressivement à comprendre la nouvelle orientation du pouvoir. Dans ces conditions, on peut penser que le monnayage au type solaire avait peut-être surtout une fonction pédagogique : il soulignait, par référence à une iconographie connue, le soutien d’une divinité unique et toute puissante à Constantin.
Mais il y a en face trop de documents qui prouvent la conversion de l’empereur en 312 pour douter de sa force dès ce moment. J’ai cité déjà les textes sur cette conversion elle-même. Mais il faudrait maintenant analyser toutes les décisions prises en faveur de l’Eglise à partir de la fin 312. Et là c’est, comme l’a dit Lane Fox, à un véritable déluge que nous sommes confrontés. Constantin fait restituer à toutes les Eglises les bâtiments et les biens confisqués lors de la persécution de 303 sans indemnités pour ceux qui les occupaient désormais. Il distribue généreusement dès 313 l’argent et les terrains, à Rome et en Afrique notamment. Il accorde surtout à l’Eglise des privilèges juridiques que le clergé et les temples païens n’ont jamais eus : en 321, le droit de recevoir des legs même si les testaments n’étaient pas faits selon les règles ; en 318 le droit de juger les clercs dans des tribunaux d’Eglise indépendants ; en 316 le droit de valider des affranchissements d’esclaves, ce qui jusque-là, en dehors des affranchissements par testament, ne pouvait être fait que devant un magistrat romain. Tout cela ne laisse aucune ambiguïté : l’empereur était bien totalement converti dès 312, même si il voulait continuer à ménager les païens.
4) Dans tous les cas, qu’on retienne 312 ou 324, le problème reste le même, surtout après ce que nous avons vu en première partie, le caractère nettement minoritaire des chrétiens :
pourquoi Constantin a-t-il fait ce choix, qui nous apparaît aujourd’hui comme un pari tout de même très audacieux ?
Trois hypothèses peuvent ici être avancées.
= a) La première est celle de l’historiographie catholique traditionnelle, que reprit au fond, à sa manière, André Piganiol : elle privilégie une approche personnalisée du problème. Constantin avait manifesté depuis longtemps des tendances monothéistes comme le prouve sa dévotion envers Apollon. Il manifestait aussi une propension à avoir des visions et à chercher des interprétations religieuses à ses rêves, comme le prouve l’histoire de la vision païenne de 310. Un choc survenu en 312 peu avant la bataille du Pont Milvius l’aurait fait basculer vers le christianisme, et la victoire obtenue aussitôt après l’aurait convaincu de la valeur de son choix, qu’il n’aurait plus renié ensuite, usant de son pouvoir pour asseoir progressivement le rayonnement de l’Eglise.
C’est une façon d’aborder l’histoire qui n’est pas à rejeter par principe, mais qui évidemment réduit le problème à sa signification purement religieuse, en faisant abstraction de toute considération politique. Or Constantin fut d’abord un extraordinaire politicien, qui toute sa vie a montré une ambition immense : il a commencé sa carrière en 306 par un coup d’Etat contre le système tétrarchique dont il avait été exclu, et il n’a cessé ensuite de combattre tous les empereurs du système pour les éliminer : son beau-père Maximien en 309, exécuté, le fils de Maximien Maxence en 312, dont le territoire fut envahi, et qui fut vaincu et décapité, son beau-frère Licinus, empereur d’Orient en 324, attaqué à son tour, défait puis liquidé ; et même son fils Crispus, César à ses côtés, éliminé pour des raisons obscures en 326. Difficile de croire dans ces conditions à une conversion, effectuée, qui plus est, en pleine guerre, qui n’aurait pas aussi des raisons politiques.
= b) Mais ces raisons restent obscures. Certains avancentque Constantin chercha ainsi à se rallier les chrétiens de Rome, qui auraient constitué une “puissante minorité”. Nous avons vu ce qu’il fallait en penser. La thèse semble d’autant moins vraisemblable que Maxence, le rival de Constantin, qui était maître de Rome, n’était en rien un persécuteur et avait même déjà rendu leurs biens aux Eglises. Les chrétiens de Rome n’étaient ni nombreux ni persécutés, et on ne voit pas donc quels espoirs politiques Constantin aurait pu fonder sur eux.
= c) L’explication, du moins c’est notre thèse, doit plutôt être cherché sur un autre plan, qui est celui de l’idéologie, et qui met en jeu plus précisément le phénomène de sacralisation du pouvoir impérial en vigueur à cette époque. Depuis la grande crise du IIIe siècle, qui avait vu une incroyable succession d’usurpations, les empereurs avaient cherché en effet à consolider le pouvoir impérial en l’appuyant plus fortement sur un support religieux. Aurélien, en 274, avait promu à cet effet le Dieu suprême Sol Invictus, dont il se disait l’élu et le vicaire. Dioclétien, en fondant la Tétrarchie, avait été plus loin à partir de 287, en prenant le surnom de Jovien, et en donnant à son collègue Maximien celui d’Herculien : les empereurs étaient officiellement les fils de Jupiter et d’Hercule, qui agissaient à travers eux. Tous les actes impériaux étaient des actes voulus par la divinité. Dans les deux cas, le message politique de ces proclamations religieuses était clair et ouvertement énoncé : il s’agissait à l’avance d’enlever toute légitimité aux usurpateurs éventuels. Seul l’empereur était élu des dieux, et seul le successeur qu’il désignait était légitime, parce que lui-même choisi, à travers l’empereur, par la divinité.
Or Constantin, lorsqu’il réalisa entre 306 et 312 son ascension politique, en éliminant peu à peu tous les empereurs concurrents en Occident, était lui-même un usurpateur. Certes, il était par le sang le fils d’un Tétrarque, Constance Chlore, mais il n’avait pas été désigné par les Tétrarques pour leur succéder. En 306, à la mort de son père, il se fit illégalement acclamer par l’armée, et s’il alla ensuite de succès en succès, ce fut cependant toujours en étant confronté à un constant problème de légitimité. C’est cela d’abord qui explique, dès 307-308, son retour au culte solaire, et sa vision d’Apollon en 310 : en guerre contre les Tétrarques, il ne pouvait invoquer Jupiter ou Hercule, et il avait dû chercher une autre légitimation divine.
Mais le problème pour lui en 312, lorsqu’il décida d’attaquer Maxence, maître de l’Italie, c’est qu’il trouva alors, sur le terrain de la légitimité divine païenne, quelqu’un d’encore plus fort que lui. Maxence lui aussi était un usurpateur depuis 306. Et comme Constantin il avait dû chercher des soutiens divins nouveaux. Mais il avait un avantage unique. Maître de Rome, il contrôlait en effet tous les grands temples des dieux protecteurs des empereurs et de l’Etat : Jupiter, Hercule, Vénus, et aussi Apollon et Sol Invictus, la grande divinité solaire. Or tout ce que nous savons de la politique de cet empereur montre précisément qu’il manifesta une dévotion extraordinaire envers tous ces dieux. C’est même un des grands paradoxes de l’histoire romaine que de constater que les faveurs publiques au paganisme ont atteint dans la capitale leur sommet juste avant l’entrée du premier empereur chrétien. Les traces en sont toujours visibles à Rome aujourd’hui : sur le forum, outre l’énorme basilique dite ” de Constantin “, en fait une construction lancée par Maxence et qui devait abriter sa statue géante, le plus grand temple de la Ville, face au Colisée, est le temple de Vénus et de Rome, parce que Maxence le fit reconstruire entre 306 et 312 en lui donnant des dimensions gigantesques.
On perçoit dès lors mieux ce que fut, sur le plan idéologique et religieux, la guerre de 312 : un conflit entre deux ambitieux, qui cherchaient à légitimer leur position par tous les artifices de la religion, mais avec un avantage certain en ce domaine pour Maxence.
Face à cela, Constantin avait un véritable handicap. Il lui fallait rehausser sa prétention au pouvoir suprême par une légitimité divine, mais celle-ci ne pouvait, pour se justifier, provenir que d’une divinité qui cumulerait deux qualités : être une divinité tout puissante, supérieure à elle seule à tous les dieux de la Rome païenne ; et être une divinité universelle, de tout l’empire, qui transcenderait les frontières.
Or devant cela, Constantin n’avait guère de choix. Il pouvait, certes, célébrer le dieu des néo-platoniciens, l’Un de Plotin, inconnaissable et inaccessible, que seuls les philosophes évoquaient : mais l’impact politique d’un tel choix aurait été quasiment nul. Ou il pouvait s’appuyer sur le dieu des chrétiens, que tout le monde désormais connaissait, parce que les chrétiens étaient présents partout, parce que la persécution venait de montrer la foi ardente que ce dieu suscitait, et parce que même Galère, le plus fanatique des Tétrarques, sur son lit de mort, en 311, venait de reconnaître l’échec de la politique de persécution, en reconnaissant dans un édit officiel l’existence légale des chrétiens, qu’il invitait désormais à prier pour le salut de l’Empire.
à En l’état actuel de nos connaissances, le doute n’est guère possible : Constantin, indépendamment de ses convictions personnelles, a choisi en octobre 312 le christianisme parce qu’il lui donnait une légitimité politique nouvelle et complètement à part, au-dessus de toutes les autres. Il a pris ses adversaires totalement de court avec ce ralliement, et le succès n’a certainement ensuite fait que le renforcer dans ses convictions. Cette explication n’exclut évidemment pas une évolution continue de l’empereur après 312 : nul doute en effet que, parti de ce choix politique et idéologique, Constantin a ensuite appris progressivement à mieux connaître le dogme, consolidant ainsi peu à peu son adhésion initiale.
C) La christianisation au IVe : modalités, causes et rythmes
Resterait maintenant à mesurer les conséquences réelles de ce choix sur l’ensemble des populations de l’empire, c’est-à-dire à faire la part des effets de la conversion de l’empereur, et des lois qu’il édicta sous l’influence de cette conversion, sur le processus de passage au christianisme des habitants du monde romain. C’est une énorme question là aussi, que je résumerai seulement..
Schématiquement, le problème se présente sous trois aspects complémentaires.
– 1) C’est d’abord celui de la volonté impériale d’évangélisation.
L’empereur converti a-t-il voulu aussitôt faire de son empire un empire chrétien ? En ce qui concerne Constantin, on l’a vu, la thèse doit être soutenue avec prudence. Il couvrit de faveurs l’Eglise, mais il fit très peu pour faire reculer le paganisme, dont il ménageait manifestement les fidèles. C’est avec ses fils, surtout Constant empereur d’Occident de 340 à 350 et Constance II empereur d’Orient de 337 à 361 que cette volonté de christianiser l’empire fut vraiment manifeste. Mais elle se traduisit en fait encore par peu de gestes. Le tournant ne se produisit vraiment que sous Théodose entre 379 et 395, lorsque les cultes païens furent finalement partout interdits : alors naquit véritablement la persécution chrétienne du paganisme, qui obligea plus tard un auteur comme Zosime à écrire dans la clandestinité.
– 2) La deuxième question est ensuite celle du rythme de la christianisation après 312.
Constate-t-on de réels changements d’abord à la suite de la conversion de Constantin, et ensuite après les lois répressives de Théodose ? Le problème redevient ici évidemment celui des sources et des instruments de mesure de la christianisation. Ils ne sont pas différents de ceux présentés pour l’avant 312 : inscriptions, textes littéraires, et listes conciliaires ont seulement l’avantage d’être désormais beaucoup plus nombreux, mais avec les mêmes interrogations sur leur représentativité.L’impression d’ensemble pour le IVe siècle reste celle de très grandes inégalités selon les régions, malgré une évidente progression d’ensemble : c’est ce qui ressort dugros dossier qui a fait l’objet récemment d’un livre d’un autre chercheur américain, Ramsay Mac Mullen (Christianiser l’empire romain),. En Afrique, où nous avons de très nombreux textes conciliaires et l’énorme documentation augustinienne, les choses sont à peu près claires : dès avant la condamnation du paganisme en 391, la cause était gagnée, et très nettement, même dans les campagnes. La découverte en 1974 de 29 lettres inédites de saint Augustin dans deux manuscrits de Marseille et de Paris, puis celle de 26 sermons également totalement inconnus du même auteur en 1990 dans un manuscrit de Mayence n’ont fait à cet égard que confirmer ce que l’on savait déjà. Tous les chrétiens n’étaient pas catholiques certes, car le schisme donatiste était extrêmement puissant, mais les païens, sauf parmi les élites urbaines, étaient en pleine déroute.
Comme partout, il faut cependant dans le détail beaucoup nuancer les formes de cette christianisation des masses : les Africains, en particulier, mêlaient à leur nouvelle religion quantité de surveillances païennes qui exaspéraient saint Augustin. La plus célèbre, parce que la mère d’Augustin elle-même en était l’adepte, était l’habitude de célébrer des banquets aux jours anniversaires des morts directement sur les tombes, comme à l’époque païenne. Les archéologues ont sur ce point totalement vérifié l’enseignement des textes : on a retrouvé quantité de dalles funéraires chrétiennes qui comportent, sculptés dans la pierre, des aménagements pour les repas, comme des assiettes en creux ou des plats. Tout récemment, une équipe franco-tunisienne à Pupput dans le Cap Bon en a sorti des exemples vraiment magnifiques. Mais les plus étonnants aménagements funéraires sont ceux qu’un autre archéologue français, Paul-Albert février avait trouvés dans les années 60 dans des nécropoles algériennes : des systèmes de tubulures en terre cuite partant de la dalle funéraire et s’enfonçant dans la terre, pour que le mort reçoive, comme à l’époque païenne, des aliments. Tout cela amène évidemment à relativiser le concept de christianisation, mais il reste que sur le fond, ces Africains avaient bien choisi le christianisme à la fin du IVe siècle.
Si on considère la Gaule en revanche, le contraste paraît en fait toujours aussi fort qu’au début du siècle. Les villes sont nettement gagnées par la nouvelle religion, mais ici la conversion des campagnes semble seulement embryonnaire. Tous les textes des années 380-400 montrent les difficultés des missionnaires auprès des paysans : on pense là surtout aux aventures de saint Martin de Tours racontées par Sulpice Sèvère, ou à la mission de Victrice de Rouen dans le pays des Morins, l’actuel Pas de Calais. Ici, c’est bien après l’interdiction formelle du paganisme en 391 que les chrétiens semblent être réellement devenus majoritaires.
– 3) Et cela m’amène à ma dernière question, qui reste la plus polémique, et qui est celle des causes de ce processus inégal mais réel de progression de l’Eglise au IVe siècle.
Deux thèses continuent en effet à s’affronter : pour les uns, la machine tournait toute seule en quelque sorte : sur l’élan acquis dans la deuxième moitié du IIIe siècle, l’évangélisation a de manière naturelle gagné les masses. Et pour d’autres, c’est l’avènement d’un christianisme religion d’Etat qui a permis vraiment la mort du paganisme.
Or, au regard de ce qui précède, on comprend qu’une réponse unique est impossible à considérer la Gaule ou la Bretagne, ce sont les partisans de la deuxième explication qui semblent avoir raison. A considérer l’Afrique ou l’Egypte, ce sont ceux de la christianisation spontanée qui paraissent l’emporter. Le vrai problème, et je vais conclure sur ce point parce qu’il semble au fond l’apport essentiel du travail des historiens des trente dernières années, c’est qu’il faut vraiment cesser de considérer l’empire romain comme un tout. Nous nous extasions trop souvent devant cette magnifique construction politique, cette unité européenne avant l’heure, vivifiée par une citoyenneté égale pour tous depuis l’édit de Caracalla. En réalité l’empire romain est toujours resté extraordinairement diversifié. Même au Bas-Empire, avec un appareil d’Etat renforcé, il a fonctionné fondamentalement comme un immense conglomérat de cités, intégrées à des provinces qui chacune gardaient une personnalité culturelle très particulière.
La fameuse question des langues suffit à le prouver Dans son diocèse d’Hippone (Annaba), saint Augustin avait besoin d’interprètes parlant le punique, la vieille langue des Carthaginois, quand il allait prêcher dans les campagnes. Au centre de l’Asie Mineure, en Galatie, saint Jérôme nous apprend à la même époque que les paysans parlaient toujours la langue de leurs ancêtres, c’est-à-dire une langue celtique proche du gaulois. Et on pourrait multiplier les exemples. Il faut donc, et c’est peu à peu la tendance qui s’impose enfin, mais difficilement, aux historiens du christianisme,cesser de chercher des explications uniques, politiques, sociales ou purement religieuses à la christianisation. Chaque région de l’empire a connu sa transformation religieuse à son rythme, et en fonction de facteurs locaux ou extérieurs qu’il faut se garder de généraliser.
Yves Modéran
Bibliographie indicative
1 Introduction générale à la période
G. W. Bowersock, P. Brown, O. Grabar, Late antiquity. A Guide to the Postclassical World, Cambridge (Mass), 1999. (la synthèse de référence désormais sur la période).
J.-M. Carrié et A. Rousselle, L’Empire romain en mutation, des Sévères à Constantin, collection ” Points “, Seuil, Paris, 1999.
Y. Modéran, L’Empire romain tardif, 235-395, éd. Ellipses, Paris, 2003.
B. Lançon, Constantin, coll. Que sais-je ?, Paris, 1998.
S. C. MIMOUNI et P. MARAVAL, Le christianisme des origines à Constantin, Paris, 2006, CXLIII-528 p. cartes.
2 Ouvrages d’intérêt historiographique
A. Piganiol, L’empereur Constantin , Paris, 1932
J. Daniélou et H. I. Marrou, Nouvelle histoire du christianisme, tome 1, Paris, Seuil, 1963.
P. VEYNE, Quand notre monde est devenu chrétien (312 – 394), Paris, 2007.
3 Enquêtes et synthèses récentes
R. TURCAN, Constantin en son temps : le baptême ou la pourpre, Dijon, 2006.
T. D. Barnes, Constantine and Eusebius, Cambridge (Mass.), 1981.
R. Lane Fox, Pagans and Christians, Londres, 1986, trad. Française : Païens et Chrétiens. La religion et la vie religieuse dans l’empire romain de la mort de Commode au concile de Nicée, Toulouse, 1997.
R. MacMullen, Christianizing the Roman Empire, Yale, 1986.
R. MacMullen, Christianity and Paganism in the Fourth to Eigth Centuries, Yale, 1999.
P. Chuvin, Chronique des derniers païens, Paris, 1990.
Ch. et L. Piétri (dir.), Histoire du christianisme, tome II, Naissance d’une chrétienté (250-430), Paris, Desclée, 1995.
P. Brown, The Rise of Western Christendom. Triumph and Diversity AD 200-1000, Londres, 1996.
Cl. Lepelley, Aspects de l’Afrique romaine : les cités, la vie rurale, le christianisme, Bari, 2001.
Yves Modéran (1955-2010)






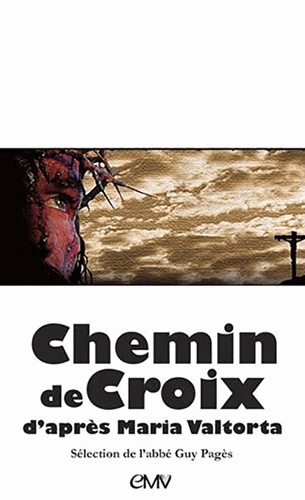










Passionnant! Merci!