LA MORT DES CATHÉDRALES PAR MARCEL PROUST (LE FIGARO-1904)
Supposez pour un instant que le catholicisme soit éteint depuis des siècles, que les traditions de son culte soient perdues. Seules, monuments devenus inintelligibles, mais restés admirables, d’une croyance oubliée, subsistent les cathédrales, muettes et désaffectées. Supposez ensuite qu’un jour, des savants, à l’aide de documents, arrivent à reconstituer les cérémonies qu’on y célébrait autrefois, pour lesquelles elles avaient été construites, qui étaient proprement leur signification et leur vie, et sans lesquelles elles n’étaient plus qu’une lettre morte ; et supposez qu’alors des artistes, séduits par le rêve de rendre momentanément la vie à ces grands vaisseaux qui s’étaient tus, veuillent en refaire pour une heure le théâtre du drame mystérieux qui s’y déroulait au milieu des chants et des parfums, entreprennent, en un mot, pour la messe et les cathédrales, ce que les félibres ont réalisé pour le théâtre d’Orange et les tragédies antiques.
Est-il un gouvernement un peu soucieux du passé artistique de la France qui ne subventionnât largement une tentative aussi magnifique ? Pensez-vous que ce qu’il a fait pour des ruines romaines, il ne le ferait pas pour des monuments français, pour ces cathédrales qui sont probablement la plus haute mais indiscutablement la plus originale expression du génie de la France ? Car à notre littérature on peut préférer la littérature d’autres peuples, à notre musique leur musique, à notre peinture et à notre sculpture, les leurs ; mais c’est en France que l’architecture gothique a créé ses premiers et ses plus parfaits chefs-d’œuvre. Les autres pays n’ont fait qu’imiter notre architecture religieuse, et sans l’égaler.
Ainsi donc (je reprends mon hypothèse), voici des savants qui ont su retrouver la signification perdue des cathédrales : les sculptures et les vitraux reprennent leurs sens, une odeur mystérieuse flotte de nouveau dans le temple, un drame sacré s’y joue, la cathédrale se remet à chanter. Le gouvernement subventionne avec raison, avec plus de raison que les représentations du théâtre d’Orange, de l’Opéra-Comique, et de l’Opéra, cette résurrection des cérémonies catholiques, d’un intérêt historique, social, plastique, musical, dont rien que la beauté est au-dessus de ce qu’aucun artiste a jamais rêvé, et dont seul Wagner s’est approché, en l’imitant, dans Parsifal.
Des caravanes de snobs vont à la ville sainte (que ce soit Amiens, Chartres, Bourges, Laon, Reims, Rouen, Paris, la ville que vous voudrez, nous avons tant de sublimes cathédrales !), et une fois par an ils ressentent l’émotion qu’ils allaient autrefois chercher à Bayreuth et à Orange : goûter l’œuvre d’art dans le cadre même qui a été construit pour elle. Malheureusement, là comme à Orange, ils ne peuvent être que des curieux, des dilettanti ; quoi qu’ils fassent, en eux n’habite pas l’âme d’autrefois. Les artistes qui sont venus exécuter les chants, les artistes qui jouent le rôle de prêtres, peuvent être instruits, s’être pénétrés de l’esprit des textes ; le ministre de l’instruction publique ne leur ménagera ni les décorations ni les compliments. Mais, malgré tout, on ne peut s’empêcher de dire : « Hélas ! combien ces fêtes devaient être plus belles au temps où c’étaient des prêtres qui célébraient les offices, non pour donner aux lettrés une idée de ces cérémonies, mais parce qu’ils avaient en leur vertu la même foi que les artistes qui sculptèrent le jugement dernier au tympan du porche, ou peignirent la vie des saints aux vitraux de l’abside. Combien l’œuvre tout entière devait parler plus haut, plus juste, quand tout un peuple répondait à la voix du prêtre, se courbait à genoux quand tintait la sonnette de l’élévation, non pas comme dans ces représentations rétrospectives, en froids figurants stylés, mais parce qu’eux aussi, comme le prêtre, comme le sculpteur, croyaient. Mais, hélas ! ces choses sont aussi loin de nous que le pieux enthousiasme du peuple grec aux représentations du théâtre et nos « reconstitutions « ne peuvent en donner une idée. »
Voilà ce qu’on dirait si la religion catholique n’existait plus et si des savants étaient parvenus à retrouver ses rites, si des artistes avaient essayé de les ressusciter pour nous. Mais précisément elle existe encore et n’a pour ainsi dire pas changé depuis le grand siècle où les cathédrales furent construites. Nous n’avons pas besoin pour nous imaginer ce qu’était, vivante et dans le plein exercice de ses fonctions sublimes, une cathédrale du XIIIe siècle, d’en faire comme du théâtre d’Orange, le cadre de reconstitutions, de rétrospectives exactes peut-être, mais glacées. Nous n’avons qu’à entrer à n’importe quelle heure du jour où se célèbre un office. La mimique, la psalmodie et le chant ne sont pas confiés ici à des artistes sans « conviction ». Ce sont les ministres même du culte qui officient, non dans une pensée d’esthétique, mais par foi, et d’autant plus esthétiquement. Les figurants ne pourraient être souhaités plus vivants et plus sincères, puisque c’est le peuple qui prend la peine de figurer pour nous, sans s’en douter. On peut dire que grâce à la persistance dans l’Église catholique des mêmes rites et, d’autre part, de la croyance catholique dans le cœur des Français, les cathédrales ne sont pas seulement les plus beaux ornements de notre art, mais les seuls qui vivent encore leur vie intégrale, qui soient res- tés en rapport avec le but pour lequel ils furent construits.
Or, la rupture du gouvernement français avec Rome semble rendre prochaine la mise en discussion et probablel’adoption d’un projet de M. Briand, aux termes duquel, au bout de cinq ans, les églises pourront être, et seront souvent désaffectées ; le gouvernement non seulement ne subventionnera plus la célébration des cérémonies rituelles dans les églises, mais pourra les transformer en tout ce qui lui plaira : musée, salle de conférence ou casino. Ô vous ! monsieur André Hallays, qui allez répétant que la vie se retire des œuvres d’art, dès qu’elles ne servent plus aux fins qui présidèrent à leur création, qu’un meuble qui devient un bibelot et un palais qui devient un musée se glacent, ne peuvent plus parler à notre cœur, et finissent par mourir, – j’espère que vous allez cesser pour un mo- ment de dénoncer les restaurations plus ou moins maladroites qui menacent chaque jour les villes de France que vous avez prises sous votre garde, et que vous allez vous lever, donner de la voix, harceler, s’il le faut, M. Chaumié, mettre en cause, au besoin, M. de Monzie, rallier M. John Labusquière, réunir la Commission des monuments historiques. Votre zèle ingénieux fut souvent efficace, vous n’allez pas laisser mourir d’un seul coup toutes les églises de France.
Il n’y a pas aujourd’hui de socialiste ayant du goût qui ne déplore les mutilations que la Révolution a infligées à nos cathédrales, tant de statues, tant de vitraux brisés. Eh bien, il vaut mieux dévaster une église que la désaffecter. Tant qu’on y célèbre la messe, si mutilée qu’elle soit, elle garde au moins un peu de vie.
Je dis projet Briand pour simplifier, les dispositions qui effrayent étant communes aux différents projets. Mais naturellement le projet Briand est beaucoup moins mauvais que les autres, étant l’œuvre d’un esprit sectaire, sans doute, mais par certains côtés, tout à fait supérieur. M. Briand, s’il ne la connaît pas, devrait bien lire une conférence de M. Charles Gide sur la séparation, conférence que le Bulletin de l’Action pour l’Union morale a publiée. M. Gide n’envisage le problème qu’au point de vue économique. Mais ces quelques pages sont ce qui a été écrit de plus profond sur ce sujet.
On peut dire aux églises ce que Jésus disait à ses disciples : « Excepté si l’on continue à manger la chair du fils de l’homme et à boire son sang. Il n’y a plus de vie en vous » (Saint Jean, VI, 55), ces pa- roles un peu mystérieuses, mais si profondes du Sauveur devenant, dans cette acception nouvelle, un axiome d’esthétique et d’architecture. Quand le sacrifice de la chair et du sang du Christ, le sacrifice de la messe, ne sera plus célébré dans les églises, il n’y aura plus de vie en elles. La liturgie catholique ne fait qu’un avec l’architecture et la sculpture de nos cathédrales, car les unes comme les autres dérivent d’un même symbolisme. On sait qu’il n’y a guère dans les cathédrales de sculpture, si secondaire qu’elle paraisse, qui n’ait sa valeur symbolique. Si, au porche occidental de la cathédrale d’Amiens, la statue du Christ s’élève sur un socle orné de roses, de lis et de vigne, c’est que le Christ a dit : « Je suis la rose de Saron. Je suis le lis de la vallée. Je suis la vigne véritable. »
Si sous ses pieds sont sculptés l’aspic et le basilic, le lion et le dragon, c’est à cause du verset du psaume XC : Inculcabis su- per aspidem et leonem. À sa gauche, est représenté, dans un pe- tit bas-relief, un homme qui laisse tomber son épée à la vue d’un animal, tandis qu’à côté de lui un oiseau continue de chanter. C’est que « le poltron n’a pas le courage d’une grive », et que ce bas-relief a pour mission de symboliser, en effet, la lâcheté comme opposée au courage, parce qu’il est placé sous la statue qui est toujours (du moins dans les premiers temps) à la gauche de la statue du Or, les cérémonies du culte participent au même symbolisme. Dans un livre admirable auquel je voudrais avoir un jour l’occasion de rendre un entier hommage, M. Émile Mâle analyse ainsi, d’après le Rational des divins offices, de Guillaume Durand, la première partie de la fête du samedi saint.
Dès le matin, on commence par éteindre dans l’église toutes les lampes, pour marquer que l’ancienne loi, qui éclairait le monde, est désormais abrogée.
Puis le célébrant bénit le feu nouveau, figure de la Loi nouvelle. Il la fait jaillir du silex, pour rappeler que Jésus-Christ est, comme le dit saint Paul, la pierre angulaire du monde. Alors, l’évêque et le diacre se dirigent vers le chœur et s’arrêtent devant le cierge pascal.
Ce cierge, nous apprend Guillaume Durand, est un triple symbole. Éteint, il symbolise à la fois la colonne obscure qui guidait les Hébreux pendant le jour, l’ancienne Loi et le corps de Jésus-Christ. Allumé, il signifie la colonne de lumière qu’Israël voyait pendant la nuit, la Loi nouvelle et le corps glorieux de Jésus-Christ ressuscité. Le diacre fait allusion à ce triple symbolisme en récitant, devant le cierge, la formule de l’Exultet.
Mais il insiste surtout sur la ressemblance du cierge et du corps de Jésus-Christ. Il rappelle que la cire immaculée a été produite par l’abeille, à la fois chaste et féconde, comme la Vierge qui a mis au monde le Sauveur. Pour rendre sensible aux yeux la similitude de la cire et du corps divin, il enfonce dans le cierge cinq grains d’encens qui rappellent à la fois les cinq plaies de Jésus-Christ et les parfums achetés par les Saintes Femmes pour l’embaumer. Enfin, il allume le cierge avec le feu nouveau, et, dans toute l’église, on rallume les lampes, pour représenter la diffusion de la nouvelle Loi dans le monde.
Mais ceci, dira-t-on, n’est qu’une fête exceptionnelle. Voici l’interprétation d’une cérémonie quotidienne, la messe, qui, vous allez le voir, n’est pas moins symbolique.
« Le chant grave et triste de l’Introit ouvre la cérémonie ; il affirme l’attente des patriarches et des prophètes. Le chœur des clercs et le chœur même des saints de l’ancienne Loi, qui soupi- rent après la venue du Messie, qu’ils ne doivent point voir. L’évêque entre alors et il apparaît comme la vivante image de Jésus-Christ. Son arrivée symbolise l’avènement du Sauveur, at- tendu par les nations. Dans les grandes fêtes, on porte devant lui sept flambeaux pour rappeler que, suivant la parole du prophète, les sept dons du Saint-Esprit se reposent sur la tête du fils de Dieu. Il s’avance sous un dais triomphal dont les quatre porteurs peuvent se comparer aux quatre évangélistes. Deux acolytes marchent à sa droite et à sa gauche et figurent Moïse et Hélie, qui se montrèrent sur le Thabor aux côtés de Jésus- Christ. Ils nous enseignent que Jésus avait pour lui l’autorité de la Loi et l’autorité des prophètes.
« L’évêque s’assied sur son trône et reste silencieux. Il ne semble prendre aucune part à la première partie de la cérémonie. Son attitude contient un enseignement : il nous rappelle par son silence que les premières années de la vie de Jésus-Christ s’écoulèrent dans l’obscurité et le recueillement. Le sous-diacre, cependant, s’est dirigé vers le pupitre, et, tourné vers la droite, il lit l’épître à haute voix. Nous entrevoyons ici le premier acte du drame de la Rédemption.
« La lecture de l’épître, c’est la prédication de saint Jean- Baptiste dans le désert. Il parle avant que le Sauveur ait commencé à faire entendre sa voix, mais il ne parle qu’aux Juifs. Aussi le sous-diacre, image du Précurseur, se tourne-t-il vers le nord, qui est le côté de l’Ancienne Loi. Quand la lecture est terminée, il s’incline devant l’évêque, comme le Précurseur s’humilia devant Jésus-Christ.
« Le chant du Graduel qui suit la lecture de l’épître se rapporte encore à la mission de saint Jean-Baptiste, il symbolise les exhortations à la pénitence qu’il adresse aux Juifs, à la veille des temps nouveaux.« Enfin, le célébrant lit l’évangile. Moment solennel, car c’est ici que commence la vie active du Messie ; sa parole se fait entendre pour la première fois dans le monde. La lecture de l’évangile est la figure même de sa prédication.
« Le Credo suit l’évangile comme la foi suit l’annonce de la vérité. Les douze articles du Credo se rapportent à la vocation des douze apôtres.
« Le costume même que le prêtre porte à l’autel », ajoute M. Mâle, les objets qui servent au culte sont autant de symboles. « La chasuble, qui se met pardessus les autres vêtements, c’est la charité qui est supérieure à tous les préceptes de la loi et qui est elle-même la loi suprême. L’étole, que le prêtre se passe au cou, est le joug léger du Seigneur ; et comme il est écrit que tout chrétien doit chérir ce joug, le prêtre baise l’étole en la mettant et en l’enlevant. La mître à deux pointes de l’évêque symbolise la science qu’il doit avoir de l’un et de l’autre Testament ; deux rubans y sont attachés pour rappeler que l’Écriture doit être interprétée suivant la lettre et suivant l’esprit. La cloche est la voix des prédicateurs. La charpente à laquelle elle est suspendue est la figure de la croix. La corde, faite de trois fils tordus, signifie la triple intelligence de l’Écriture, qui doit être interprétée dans le triple sens historique, allégorique et moral. Quand on prend la corde dans sa main pour ébranler la cloche, on exprime symbo- liquement cette vérité fondamentale que la connaissance des Écritures doit aboutir à l’action. »
Ainsi, tout, jusqu’au moindre geste du prêtre, jusqu’à l’étole qu’il revêt, est d’accord pour le symboliser avec le senti- ment profond qui anime la cathédrale tout entière et qui, comme l’a très bien dit M. Mâle, est le génie même du moyen âge.
Jamais spectacle comparable, miroir aussi géant de la science, de l’âme et de l’histoire ne fut offert aux regards et à l’intelligence de l’homme. Le même symbolisme embrasse jusqu’à la musique, qui se fait entendre alors dans l’immense vaisseau et de qui les sept tons grégoriens figurent les sept vertus théologales et les sept âges du monde. On peut dire qu’une représentation de Wagner à Bayreuth est peu de chose auprès de la célébration de la grand’messe dans la cathédrale de Chartres.
Sans doute ceux-là seuls qui ont étudié l’art religieux du moyen âge sont capables d’analyser complètement la beauté d’un tel spectacle. Et cela suffirait pour que l’État eût obligation de veiller à sa perpétuité. C’est ainsi que l’État subventionne les cours du Collège de France, qui ne s’adressent cependant qu’à un petit nombre de personnes et qui, à côté de cette résurrection intégrale qu’est une grand’messe dans une cathédrale, paraissent de froides dissections. Et à côté de l’exécution de pareilles symphonies, les représentations de nos théâtres également subventionnés correspondent à des besoins littéraires bien mesquins. Mais empressons-nous d’ajouter que ceux-là qui peuvent lire à livre ouvert dans la symbolique du moyen âge ne sont pas les seuls pour qui la cathédrale vivante, c’est-à-dire la cathédrale sculptée, peinte, chantante, soit le plus grand des spectacles. C’est ainsi qu’on peut sentir la musique sans con- naître l’harmonie. Je sais bien que Ruskin montrant quelles rai- sons spirituelles expliquent la disposition des chapelles dans l’abside des cathédrales, a dit : « Jamais vous ne pourrez vous enchanter des formes de l’architecture si vous n’êtes pas en sympathie avec les pensées d’où elles sortirent. » Il n’en est pas moins vrai que nous connaissons tous le fait d’un ignorant, d’un simple rêveur, entrant dans une cathédrale, sans essayer de comprendre, se laissant aller à ses émotions, et éprouvant une impression plus confuse sans doute, mais peut-être aussi forte. Comme témoignage littéraire de cet état d’esprit, fort différent à coup sûr de celui du savant dont nous parlions tout à l’heure, se promenant dans la cathédrale comme dans une « forêt de symboles, qui l’observent avec des regards familiers », mais qui permet de trouver pourtant dans la cathédrale, à l’heure des offices, une émotion vague mais puissante, je citerai la belle page de Renan appelée la Double Prière :
Un des plus beaux spectacles religieux qu’on puisse encore contempler de nos jours (et qu’on ne pourra plus bientôt contempler si la Chambre vote le projet Briand) est celui que présente à la tombée de la nuit l’antique cathédrale de Quimper. Quand l’ombre a rempli les bas- côtés du vaste édifice, les fidèles des deux sexes se réunissent dans la nef et chantent en langue bretonne la prière du soir sur un rythme simple et touchant. La cathédrale n’est éclairée que par deux ou trois lampes. Dans la nef, d’un côté sont les hommes, debout ; de l’autre, les femmes agenouillées forment comme une mer immobile de coiffes blanches. Les deux moitiés chantent alternativement et la phrase commencée par l’un des chœurs est achevée par l’autre. Ce qu’ils chantent est fort beau. Quand je l’entendis, il me sembla qu’avec quelques légères transformations on pourrait l’accommoder à tous les états de l’humanité. Cela surtout me fit rêver une prière qui, moyennant certaines variations, pût convenir également aux hommes et aux femmes.
Entre cette vague rêverie qui n’est pas sans charme et les joies plus conscientes du « connaisseur » en art religieux, il y a bien des degrés. Rappelons pour mémoire le cas de Gustave Flaubert étudiant, mais pour l’interpréter dans un sentiment moderne, une des plus belles parties de la liturgie catholique :
Le prêtre trempa son pouce dans l’huile sainte et commença les onctions sur ses yeux d’abord… sur ses narines friandes de brises tièdes et de senteurs amoureuses, sur ses mains qui s’étaient délectées aux con tacts suaves… sur ses pieds enfin, si rapides quand ils couraient à l’assouvissance de ses désirs, et qui maintenant ne marcheraient plus.
C’est ainsi que devant cette réalisation artistique, la plus complète qui fut jamais puisque tous les arts y collaborèrent, du plus grand rêve auquel se soit jamais élevée l’humanité, on peut rêver de bien des manières, et la demeure est assez grande pour que nous y puissions tous trouver place. La cathédrale qui abritetant de saints, de patriarches, de prophètes, d’apôtres, de rois, de confesseurs, de martyrs, que des générations entières se pressent jusqu’à l’entrée des porches, souvent suppliantes, angoissées, élevant l’édifice en tremblant sous le ciel comme un long gémissement, tandis que des anges se penchent en souriant du haut des galeries qui, dans l’encens rose et bleu du soir et l’or éblouissant du matin, apparaissent vraiment comme « les balcons du ciel », la cathédrale, dans son immensité, peut aussi bien donner asile au lettré qu’au croyant, au vague rêveur qu’à l’archéologue ; ce qui importe, c’est qu’elle reste vivante et que du jour au lendemain la France ne soit pas transformée en une grève desséchée où de géants coquillages ciselés sembleraient comme échoués, vidés de la vie qui les habita, et n’apportant même plus à l’oreille qui se pencherait sur eux la vague rumeur d’autrefois, simples pièces de musée, musées glacés elles- mêmes. « Il n’est pas trop tard, écrivait il y a quelques années M. André Hallays, pour relever une idée saugrenue, qui paraît-il est née dans la cervelle de quelques Vézelayens. Ceux-ci voudraient qu’on désaffectât l’église de Vézelay. L’anticléricalisme inspire de grandes sottises. Désaffecter cette basilique, c’est vouloir lui retirer le peu d’âme qui lui reste. Lorsqu’on aura éteint la petite lampe qui brille au fond du chœur, Vézelay ne se- ra plus qu’une curiosité archéologique. On y respirera l’odeur sépulcrale des musées. C’est en continuant à remplir l’office au- quel elles furent primitivement destinées que les choses, dus- sent-elles lentement mourir à la tâche, gardent leur beauté et leur vie. Croit-on que dans les musées de sculpture comparée, les moulages des célèbres stalles en bois sculptés de la cathédrale d’Amiens peuvent donner une idée des stalles elles- mêmes, dans leur vieillesse auguste et toujours exerçante? Tandis qu’au musée un gardien nous empêche d’approcher de leurs moulages, les stalles inestimablement précieuses, si vieilles, si illustres, et si belles, continuent à exercer à Amiens leurs fonctions modestes de stalles, – dont elles s’acquittent de- puis plusieurs siècles à la grande satisfaction des Amiénois, – comme ces artistes qui parvenus à la gloire, n’en continuent pas moins à garder un petit emploi ou à donner des leçons. Ces fonctions consistent, avant même d’instruire les âmes, à supporter les corps, et c’est à quoi, rabattues pendant chaque office et présentant leur envers, elles s’emploient modestement. Bien plus, les bois toujours frottés de ces stalles ont peu à peu revêtu ou plutôt laissé paraître cette sombre pourpre qui est comme leur cœur et que préfère à tout, jusqu’à ne plus pouvoir regarder les couleurs des tableaux qui semblent, après cela, bien grossières, l’œil qui s’en est une fois enchanté. C’est alors comme une sorte d’ivresse qu’on éprouve à goûter, dans l’ardeur toujours plus enflammée du bois ce qui est comme la sève, avec le temps, débordante de l’arbre. La naïveté des personnages ici sculptés prend de la matière dans laquelle ils vivent quelque chose comme de deux fois naturel. Et pour tous ces fruits, ces fleurs, ces feuilles, ces branches, ces végétations amiénoises que le sculpteur amiénois a sculptés dans du bois d’Amiens, les frottements divers y ont laissé paraître ces admirables oppositions de tons où la feuille se détache d’une autre couleur que la tige, faisant penser à ces nobles accents que M. Gallé a su tirer du cœur harmonieux des chênes.
Ce n’est pas seulement aux chanoines suivant l’office dans ces stalles dont les accoudoirs, les miséricordes et la rampe ra- content l’Ancien et le Nouveau Testament, ce n’est pas seulement au peuple emplissant l’immense nef, que la cathédrale, si le projet de M. Briand était voté, se trouverait fermée, ne pourrait plus donner la messe et les prières. Nous disions tout à l’heure que presque toutes les images dans une cathédrale étaient symboliques. Quelques-unes ne le sont point. Ce sont les images peintes ou sculptées de ceux qui ayant contribué de leurs deniers à la décoration de la cathédrale voulurent y conserver à jamais une place pour pouvoir, des balustres de la niche ou de l’enfoncement du vitrail, suivre silencieusement les offices, et participer sans bruit aux prières, in sæcula sæculorum. On sait que, les bœufs de Laon ayant chrétiennement monté jusque sur la colline où s’élève la cathédrale les matériaux qui servirent à la construire, l’architecte les en récompensa en dressant leurs statues au pied des tours, d’où vous pouvez les voir encore aujourd’hui, dans le bruit des cloches et la stagnation du soleil, lever leurs têtes cornues au-dessus de l’arche sainte et colossale jusqu’à l’horizon des plaines de France leur « songe intérieur ». Pour des bêtes, c’est tout ce qu’on pouvait faire : aux hommes, on accordait mieux.
Ils entraient dans l’église, ils y prenaient leur place qu’ils gardaient après leur mort et d’où ils pouvaient continuer, comme au temps de leur vie, à suivre le divin sacrifice, soit que penchés hors de leur sépulture de marbre, ils tournent légèrement la tête du côté de l’évangile ou du côté de l’épître, pouvant apercevoir, comme à Brou, et sentir autour de leur nom l’enlacement étroit et infatigable des fleurs emblématiques et d’initiales adorées, gardant parfois jusque dans leur tombeau, comme à Dijon, les couleurs éclatantes de la vie ; soit qu’au fond du vitrail dans leurs manteaux de pourpre, d’outre-mer ou d’azur, qui emprisonne le soleil, s’en enflamme, remplissent de couleurs ses rayons transparents et brusquement les délivrent, multicolores, errant sans but parmi la nef qu’ils teignent, dans leur splendeur désorientée et paresseuse, leur palpable irréalité, ils restent les donateurs qui, à cause de cela même, avaient mérité la concession d’une prière à perpétuité. Et tous, ils veulent que l’Esprit-Saint, au moment où il descendra de l’Église, reconnaisse bien les siens. Ce n’est pas seulement la reine et le prince qui portent leurs insignes, leur couronne ou leur collier de la Toison d’or. Les changeurs se sont fait représenter vérifiant le titre des monnaies, les pelletiers vendant leurs fourrures (voir dans Mâle la reproduction de ces deux vitraux), les bouchers abattant des bœufs, les chevaliers portant leur blason, les sculpteurs taillant des chapiteaux. Ô vous tous, de vos vitraux de Chartres, de Tours, de Bourges, de Sens, d’Auxerre, de Troyes, de Clermont-Ferrand, de Toulouse, tonneliers, pelletiers, épciers, pèlerins, laboureurs, armuriers, tisserands, tailleurs de pierre, bouchers, vanniers, cordonniers, changeurs, ô vous, grande démocratie silencieuse, fidèles obstinés à entendre l’office, non pas dématérialisés mais plus beaux qu’aux jours de votre vie, dans la gloire de ciel et de sang du précieux vitrage, – vous n’entendrez plus la messe que vous vous étiez assurée en donnant pour l’édification de l’église le plus clair de vos deniers. Les morts ne gouvernent plus les vivants, selon la parole pro fonde. Et les vivants oublieux cessent de remplir les vœux des morts.
Mais laissons les tonneliers de rubis, les vanniers de rose et d’argent, inscrire au fond du vitrail la « muette protestation » que M. Jaurès saurait nous rendre avec tant d’éloquence et que nous le supplions de faire parvenir jusqu’aux oreilles des députés, et, oubliant ce peuple innombrable et silencieux, ancêtres d’électeurs dont la Chambre ne se soucie guère, pour finir, résumons-nous.
Premièrement: la protection même des plus belles œuvres de l’architecture et de la sculpture françaises qui mourront le jour où elles ne serviront plus au culte des besoins duquel elles sont nées,.qui est leur fonction comme elles sont ses organes, qui est leur explication parce qu’il est leur âme, fait un devoir au gouvernement d’exiger que le culte soit perpétuellement célébré dans les cathédrales au lieu que le projet Briand l’autorise à faire des cathédrales, au bout de quelques années, tels musées ou salles de conférences (à supposer le mieux) qu’il lui plaira, et même, si le gouvernement ne prenait pas cette initiative, auto- rise le clergé s’il en trouve la location trop dispendieuse (et par le fait qu’il ne sera plus subventionné, on peut le dire le force) à n’y plus célébrer d’offices.
Deuxièmement: le maintien du plus grand ensemble artistique qui se puisse concevoir, historique et pourtant vivant, des millions pour la reconstitution duquel on ne reculerait devant aucune dépense s’il n’existait plus, à savoir la messe dans les cathédrales, fait un devoir au gouvernement de subventionner l’Église catholique pour l’entretien d’un culte qui importe autrement à la conservation du plus noble art français (pour continuer à nous tenir uniquement à ce point de vue profane), que les conservatoires, théâtres de comédie ou de musique, entreprise de reconstitution des tragédies antiques au théâtre d’Orange, etc., etc., toutes sociétés ayant un but artistique contestable, conservant des œuvres dont beaucoup sont faibles (que reste-t-il devant le chœur de Beauvais, ou les statues de Reims du Jour, de l’Aventurière ou du Gendre de M. Poirier ?), tandis que l’œuvre qu’est la cathédrale du moyen âge avec ses milliers de figures peintes ou sculptées, ses chants, ses offices, est la plus noble de toutes celles à laquelle se soit jamais haussé le génie de la France.
Et nous n’avons parlé dans cet article que des cathédrales pour donner à ces conséquences du projet Briand leur forme la plus frappante, la plus choquante pour l’esprit du lecteur. Mais on sait que la distinction entre les églises cathédrales et les autres est tout à fait artificielle, puisqu’il suffisait, à l’occasion d’une fête, d’y dresser la cathèdre d’un évêque, pour qu’une église devint momentanément cathédrale. Ce que j’ai dit des cathédrales s’applique à toutes les belles églises de France et on sait qu’il y en a des milliers. En suivant une route française entre les champs de sainfoin et les clos de pommiers qui se rangent de chaque côté pour la laisser passer « si belle », c’est presque à chaque pas que vous apercevez un clocher qui s’élève contre l’horizon orageux ou clair, traversant, les jours de pluie ensoleillée, un arc-en-ciel qui, comme une mystique auréole reflétée sur le ciel prochain de l’intérieur même de l’église entr’ouverte, juxtapose sur le ciel ses couleurs riches et distinctes de vitrail ; c’est presque à chaque pas que vous apercevez un clocher s’élevant au-dessus des maisons qui regardent à terre, comme un idéal, s’élançant dans la voix des cloches, à laquelle se mêle, si vous approchez, le cri des oiseaux. Et bien souvent vous pouvez affirmer que l’église au-dessus de laquelle il s’élève ainsi contient de belles et graves pensées sculptées et peintes, et d’autres pensées qui n’ayant pas été appelées à une vie aussi distincte et sont restées plus vagues, à l’état de belles lignes d’architecture, mais aussi puissantes ainsi, quoique plus obscures, et capables d’entraîner notre imagination dans le jaillissement de leur essor ou de l’enfermer tout entière dans la courbe de leur chute. Là, des balustres charmants d’un balcon roman ou du seuil mystérieux d’un porche gothique entr’ouvert qui unit à l’obscurité illuminée de l’église le soleil dormant à l’ombre des grands arbres qui l’entourent, il faut que nous continuions à voir la procession sortir de l’ombre multicolore qui tombe des arbres de pierre de la nef et suivre, dans la campagne, entre les piliers trapus que surmontent des chapiteaux de fleurs et de fruits, ces chemins dont on peut dire, comme le Prophète disait du Seigneur : « Tous ses sentiers sont la paix ». Enfin nous n’avons invoqué en tout ceci qu’un intérêt artistique. Cela ne veut pas dire que le projet Briand n’en menace pas d’autres et qu’à ces autres nous soyons indifférent. Mais enfin c’est à ce point de vue que nous avons voulu nous placer. Le clergé aurait tort de repousser l’appui des artistes. Car à voir combien de députés, quand ils ont fini de voter des lois anticléricales, partent faire un tour aux cathédrales d’Angleterre, de France ou d’Italie, rapportent une vieille chasuble à leur femme pour en faire un manteau ou une portière, élaborent dans leur cabinet des projets de laïcisation devant la reproduction photo- graphique d’une « Mise au Tombeau », marchandent à un brocanteur le volet d’un retable, vont pour leur antichambre cher- cher jusqu’en province des fragments de stalles d’église qui y serviront de porte-parapluie et le Vendredi Saint à la « Schola cantorum », sinon même à l’église Saint-Gervais, écoutent « religieusement », comme on dit, la messe du Pape Marcel, on peut penser que le jour où nous aurions persuadé tous les gens de goût de l’obligation que c’est pour le gouvernement, de subventionner les cérémonies du culte, nous aurions trouvé comme alliés et soulevé contre le projet Briand nombre de députés, même anticléricaux.
MARCEL PROUST. Le Figaro, 16 août 1904.
_______________________
Dans Du côté de chez Swann, publié pour la première fois en 1913, on lit :
« Combray, de loin, à dix lieues à la ronde, vu du chemin de fer quand nous y arrivions la dernière semaine avant Pâques, ce n’était qu’une église résumant la ville, la représentant, parlant d’elle et pour elle aux lointains, et, quand on s’approchait, tenant serrés autour de sa haute mante sombre, en plein champ, contre le vent, comme une pastoure ses brebis, les dos laineux et gris des maisons rassemblées qu’un reste de remparts du Moyen Âge cernait ca et là d’un trait aussi parfaitement circulaire qu’une petite ville dans un tableau primitif. » (p. 47 de mon édition : Gallimard, coll. Folio classique, 2003)
Proust revient plus loin sur l’église de Combray et notamment sur son clocher :
« Et dans une des plus grandes promenades que nous faisions de Combray, il y avait un endroit où la route resserrée débouchait tout à coup sur un immense plateau fermé à l’horizon par des forêts déchiquetées que dépassait seule la fine pointe du clocher de Saint-Hilaire, mais si mince, si rose, qu’elle semblait seulement rayée sur le ciel par un ongle qui aurait voulu donner à ce paysage, à ce tableau rien que de nature, cette petite marque d’art, cette unique indication humaine ». (p. 62)
« C’était le clocher de Saint-Hilaire qui donnait à toutes les occupations, à toutes les heures, à tous les points de vue de la ville, leur figure, leur couronnement, leur consécration. […] Même dans les courses qu’on avait à faire derrière l’église, là où on ne la voyait pas, tout semblait ordonné par rapport au clocher surgi ici ou là entre les maisons, peut-être encore plus émouvant encore quand il apparaissait ainsi sans l’église. » (p. 64).
Pour revenir à Du côté de chez Swann :
« C’était toujours à lui [le clocher] qu’il fallait revenir, toujours lui qui dominait tout, sommant les maisons d’un pinacle inattendu, levé devant moi comme le doigt de Dieu dont le corps eût été caché dans la foule des humains sans que je le confondisse pour cela avec elle. » (p. 66)
http://www.delitdimages.org/la-mort-des-cathedrales-par-marcel-proust-le-figaro-1904/#comment-51536







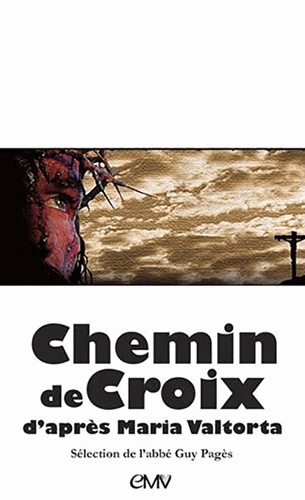










Cet article de Proust est d’autant plus précieux que son auteur était juif mais aussi homosexuel.
Il faut donc être particulièrement sectaire comme peuvent l’être les Francs-Macs et les anti-cléricaux de tout poil pour vouloir saper les fondements- mêmes de la France comme ils n’arrêtent pas de le faire, hélas avec succès, depuis la funeste Révolution dite française.
Mais tout cela se paie et l’on voit d’ores et déjà les fruits empoisonnés de leur action agressive et destructrice qui a pu être ralentie tant qu’une proportion significative de la population gardait un sentiment chrétien, mais aujourd’hui où à peine 4 à 5% vont à la Messe tous les dimanches (et ça continue à se dégrader…), et où 30% seulement des enfants font leur catéchisme… la France sera majoritairement païenne dans une ou deux générations.
Les ennemis de l’Église, haineux et aveugles, sont tout simplement en train de couper la branche sur laquelle ils sont assis.
Si la France n’est plus chrétienne, il ne faut pas s’étonner qu’elle change de nature et finisse par disparaître.
Contrairement à ce que disent certains, dont le Général de Gaulle, la France n’est pas éternelle, elle est bel et bien mortelle et je me dis que si le Général revenait aujourd’hui, il ne reconnaîtrait pas son cher et vieux pays, lui qui ne voulait pas que Colombey-les-deux-Églises devienne un jour Colombey-les-deux-Mosquées.